POUR ÉCOUTER L’ÉMISSION DU 24 SEPT 24 , CLIQUEZ ICI
Violeta Belhouchat pour son livre « CLITORIS 4U». Ed. Belhouchat Illustrations Javiera Hernandez
Livre sur l'anatomie du clitoris avec un grand nombre d'illustrations détaillées et schémas. Pour en savoir plus sur cet organe peu représenté actuellement et dans l’histoire.
Pour les étudiant.es en médecine, professeur.es de biologie, sage-femmes, gynécologues et sexothérapeutes. Les personnes engagées contre les Mutilations Génitales Féminines trouveront aussi un outil de sensibilisation.
FEMMAGE à Catherine RIBEIRO partie le 23 aout 2024
Informations militantes, La médiathèque, Spectacles, expos, etc... infos détaillées (voir sur Blogger).
Musiques : "Frangines" Anne Sylvestre « Hymen » Claude Michel, « Danse moi vers la fin de l’amour » Greame Allright (L. Cohen), « Why » Jimmy Somerville/communards, « Comes » Muriel Grossmann, « Frères humains », « Insoumission totale », « L’enfant du soleil couchant » Catherine Ribeiro, « Dans nos chants » Edwige et Anne des Entresorceleuses
BLOGGER
https://remuemeningesfeministe.blogspot.com/2024/09/24-sept-24-clitoris-4u-for-you-une.html
Nous recevons au studio de Radio Libertaire,Violeta Belhouchat pour son livre "Clitoris 4U (For you), une interview" Ed. Belhouchat
Illustrations Javiera Hernandez
Livre illustré sur l'anatomie du clitoris avec un grand nombre d'illustrations inédites et détaillées et des schémas à couleur. Idéal pour les personnes qui veulent ou qui ont besoin d'en savoir plus sur cet organe peu représenté actuellement et dans l’histoire.
Bien que ce livre soit destiné à un public plus large, il peut également être utile pour les étudiant.es en médecine qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur l’anatomie du clitoris et sur la bibliographie autour de cet organe. Les schémas peuvent être utiles aux professeur.es de biologie, mais aussi aux sage-femmes, gynécologues et sexothérapeutes. Les étudiant.es et professionnel.les de l'illustration médicale trouveront dans cet ouvrage un partie spéciale "description des illustrations". Les personnes engagées contre les Mutilations Génitales Féminines trouveront dans cet ouvrage, un outil de sensibilisation.
FEMMAGE à Catherine RIBEIRO qui nous a quitté le 23 aout 2024
Informations militantes, La médiathèque de Remue-Méninges féministe, Spectacles, expos, etc... voir infos détaillées ci-dessous sur Blogger
Musiques : "Frangines" Anne Sylvestre (indicatif début), « Hymen » Claude Michel, « Danse moi vers la fin de l’amour » Greame Allright (L. Cohen), « Why » Jimmy Somerville/Les communards, « Comes » Muriel Grossmann Quartet concert à Jazz à la Villette 2024, « Frères humains », « Insoumission totale », « L’enfant du soleil couchant » Catherine Ribeiro, « Dans nos chants » Edwige et Anne des Entresorceleuses (indicatif de fin).
Informations militantes
Avortement
: le 28 septembre 2024, manifestons pour le droit à l'IVG dans le
monde entier !
RDV 14h30 Port Royal
Lettre de femmage à Catherine RIBEIRO.
Chère Catherine. Chère Ribeiro, belle, tendre et rebelle.
Nous n’avons pas le choix : il faut s’y faire comme à chaque fois, mais, à ton grand départ, je ne m’y fais pas encore…le temps m’aidera.
Toi qui évoquais la mort dans certaines de tes chansons, « Cette toute belle, qui te faisait des clins d’yeux et tours de reins indécents » comme tu l’écrivais en 1982 dans « Guet-apens », est venue s’allonger à tes cotés le 23 aout 2024 et, cette fois-ci, tu l’as suivie.
Et te voilà déjà en cendres, si vite, trop vite, sans le temps de te faire un véritable adieu et femmage.
Je n’entendrai plus jamais ta voix vivante et ta présence va me manquer, comme à beaucoup d’entre nous.
Quand je me sentais mal dans ce monde trop souvent violent et cruel, ton énergie et ta lucidité me redonnaient du courage, et même si tu nous laisses une centaine de chansons, mes préférées resteront tes 2 albums celui de 1972, ta première version de « PAIX » et « Un jour la mort » où tu demandais à la mort « de te renvoyer du côté de la vie par besoin de te battre pour un autre monde, de connaitre l’an 01 et d’embrasser à pleine bouche les lèvres chaudes des garçons et des filles », et l’album « Le rat débile et l’homme des champs » de 1974.
L’Album « PAIX » fut vendu à 50 000 exemplaires à une époque où internet n'existait pas encore.
Je ne sais pas de quelle façon tu es partie mais j’espère en paix. Sortie de « ce monde pas fait pour toi car fait pour personne » écrivais-tu dans « Poème non épique N°3 » en 1975.
Tu avais créé ton premier groupe « 2 BIS » en 1969 avant de l’appeler « ALPES » l’année d’après, avec Patrice MOULLET, ton complice et ami musicien rencontré sur le tournage du film « Les carabiniers » en 1963, qui a composé la plupart de tes musiques et t’a accompagné tant d’années.
Déjà en 1971 le magazine Rock and folk te classait parmi les dix meilleures interprètes du monde.
Dans ce premier concert où je t’ai entendu chanter, sous un chapiteau entièrement rempli, j’ai compris tes mots et de suite aimé, je me retrouvais dans tes révoltes et l’indignation de ce monde.
Que ce soit dans les festivals « pop » comme nous les appelions dans les années 70/80, dans les chapelles où tu aimais chanter ou dans les salles, tes concerts étaient toujours complets.
Tu éteignais les lumières pour n'allumer que la scène de grosses bougies et dès les premiers sons du percuphone, un des nombreux instruments inventés et fabriqués par Patrice Moullet, un total silence dominait l’espace. Et tu arrivais jusqu’au micro calmement, grande et féline, vêtue de noir et ta voix puissante et crescendo enveloppait tout l’espace.
Toujours des moments forts et émouvants partagés avec un public attentif et fidèle
Nous nous sommes rencontrées la première fois après un de tes concerts dans une chapelle, à la Rochelle dans les années 1970. « C’est sans doute les plus belles prières entendues dans cet endroit » m’avait dit l’amie qui m’accompagnait et qui elle, tout le long du concert, flirtait de loin avec un de tes musiciens.
Après le concert, quand le public fut parti, laissant mon amie continuer à faire plus ample connaissance, je suis allée te voir dans une pièce qui vous servait de loges. Nous nous sommes regardées et après un « Oh tu es là ! » de surprise en me voyant, tu t’es avancée pour m’embrasser, pensant que nous étions amies. Moment troublant qui nous a laissé quelques minutes déconcertées quand je t’ai fait comprendre ton erreur avant d’échanger quelques mots.
Je me souviens t’avoir dit avoir très soif, les magasins étaient fermés à cette heure tardive et tu m’avais spontanément tendu la bière que tu buvais. Touchée par ton geste spontané, je n’ai pas osé te dire que je n’aimais pas trop la bière, que j’ai bu. Nous devions diner ensemble avec tes musiciens mais le travail matinal que j’exerçais à l’époque m’avait obligé à reprendre la route sans diner cette nuit-là.
Je ne regrette rien mais si le même film se rejouait, je sais maintenant que je ne me priverai pas par conscience professionnelle, de prolonger des moments magiques partagés comme ceux-là que j’aime tant vivre dans cette vie. Nous avons échangé par la suite quelques lettres.
Dans les années 80/90, sur Radio Libertaire, j’assurais la technique son et co-animais si besoin, l’émission « Fruits de la passion » de Gil Cerisay, chanteur militant homosexuel qui était aussi un de tes bons amis. Il t’a invité plusieurs fois sur l’antenne, ainsi nous nous sommes revues. Ensuite je t’ai présentée à Nelly Trumel pour qui j’assurais aussi la technique son dans son émission « Femmes libres » et qui ensuite t’invita sur l’antenne de Radio Libertaire. Depuis, Nelly nous a quitté mais l’émission existe toujours le mercredi soir à 18h30, animée par Hélène.
Ainsi nous nous sommes rencontrées plusieurs fois à diverses occasions et nous avons gardé le lien. Nous sentions mutuellement un courant d’énergie passer entre nous, comme deux sœurs se retrouvant.
L’année dernière, en 2023, j’avais prévu de te rendre visite quelques jours pour faire une interview sur ta vie de femme et de chanteuse mais un accident assez grave en aout m’a obligée à mettre une partie de mon temps en parenthèse pendant plus d’une année. En juillet de cette année, je commençais à « immerger » et je planifiais l’interview en septembre. J’ai su plus tard que tu avais commencé de ton côté à écrire ton autobiographie.
Alors quand le 23 aout j’ai reçu le texto « Catherine Ribeiro est décédée », j’ai reçu un choc dont je ne me suis pas encore complètement remise.
Il me reste tes vinyles et CD pour entendre ta voix, le DVD de ton concert aux Bouffes du Nord à Paris en 95, tes petits mots affectueux, quelques photos de nos rencontres, ton livre « l’enfance » écrit en 1999 et ton 06 qui ne répondra plus jamais.
Ton dernier concert fut à Palaiseau en 2007 où fut enregistré ton dernier CD Live suivi de 3 jours au Bataclan en 2008 « à guichet fermé ». A cette occasion, tu m’avais dit « c’est incroyable, ce que j’ai écrit il y a plus de 30 ou 40 ans est toujours d’actualité. Je pourrai écrire exactement les mêmes textes aujourd’hui ». « Et oui, t’avais-je répondu, je crains que nous soyons condamnées à résister toute notre vie pour essayer un monde meilleur ».
J’espère que là où tu es maintenant, tu as rencontré nos amies rebelles parties avant toi : Colette, Colette Magny, Anne, Anne Sylvestre, Gil, Gil Cerisay, Léo, Léo Ferré et qu’ensemble vous chantez les chansons que nous continuons d’aimer, celles qui donnent l’espoir d’un monde meilleur et égalitaire pour tous les peuples et dans lequel les marchands d’armes et les exploiteurs en tous genres n’existeront plus. Et puis auprès de Ioana, ta fille, partie elle aussi trop tôt, victime de drogues dures pour qui tu as écrit plusieurs chansons dont « Héro zéro ».
Catherine tu resteras toujours l’une des plus grandes chanteuses françaises avec ta voix unique et ta personnalité rebelle.
Adieu la belle.
Une autre Catherine, Paris Septembre 2024
Les activités à la Maison des Femmes de Paris - septembre 2024
Nos accueils et actions avec leurs coordonnées
Accueil pour toutes sans rendez-vous : mardi 13h-17h30, jeudi et vendredi 11h-17h30 - téléphone : 01 43 43 41 13 mdfdeparis@gmail.com
Action « contre les violences masculines envers les femmes et les mineures » mardi et mercredi de 9h30 à 17h30 : écoute, accompagnement, groupes de parole, art-thérapie, conseil juridique, écoute confidentielle par une psychologue clinicienne, accueil spécifique pour les jeunes femmes… contact : mdfparis.actionviolences@gmail.com Téléphone : 06 73 72 43 84
Action insertion emploi : Contact (lundi et jeudi matin) : tel 07 58 02 81 31, mail mdfdeparisemploi@gmail.com
Permanence en Langue des signes pour les femmes sourdes sur RV : vendredi 14h-18h. Contact : rdv.apjs@gmail.com
SMS 06 43 94 73 48
Nos rendez- vous
Session d’accompagnement vers l’emploi octobre à décembre 2024, 2 jours par semaine Réunion d’accueil le lundi 30 sept. à 10h (inscription recommandée. mail : mdfdeparisemploi@gmail.com)
Groupe de parole pour les femmes qui subissent ou ont subi des violences dans le couple et souhaitent travailler sur le lien mère enfant Pour se reconstruire, sortir de l’isolement, créer de la solidarité. Mercredi de 14h à 16h : 02 octobre, 27 novembre, 18 décembre
Les Ateliers art-thérapie, s’exprimer par les collages, le dessin, la peinture mercredi après-midi : 9 octobre, 23 octobre, 18 décembre. (RV à 12h pour un repas partagé. Atelier de 13h30 à 15h30)
Permanences de conseil juridique : vendredi après-midi sur rendez-vous (14h30, 15h15 et 16h) alternativement « droit d’asile et droit des étrangers » / « droit pénal et droit de la famille ». Organisées par la Maison des femmes de Paris mdfdeparis@gmail.com et le RAJFIRE rajfire.asso@gmail.com Aide aux démarches administratives du quotidien » : mardi 13h 15h40, jeudi 11h-17h vendredi 13h-15h. Prise de RV à l’accueil de la MDF ou par mail : mdfdeparis@gmail.com mais vous pouvez aussi venir directement s’il y a de la place vous serez reçues !
Les repas partagés à préparer et déguster ensemble. Un moment de convivialité le vendredi une fois par mois (RV à 11h pour préparer ensemble le repas). Pour la fin de l’année 2024. Le premier vendredi du mois : 04 octobre, 08 novembre (pas le 1er qui est un jour férié) et le 06 décembre
Maison des femmes de Paris
163 rue de Charenton Escalier 13 - Boite 144, 75012 Paris.
Accueil sans RV mardi 13h-17h, jeudi et vendredi 11h-17h
mdfdeparis@gmail.com 01 43 43 41 13
Rez de chaussée sur la rue, en face de la boutique informatique TDI system
Participez aux 20 ans de Face à l’inceste !
A l’occasion des 20 ans de Face à l’inceste (AIVI à l’origine), nous lançons l’opération #Tousprotecteurs
Au moment où notre société prend de plus en plus conscience de la réalité de l’inceste, nous souhaitons engager les citoyens à combattre le silence imposé aux victimes et réaffirmer notre volonté à construire un avenir plus juste et solidaire.
Vous voulez que l’inceste devienne une grande cause nationale en France ?
Vous souhaitez apporter votre « pierre à l’édifice » et devenir protecteur à votre tour ?
Alors, engagez-vous en organisant à votre échelle un événement local : au bureau, avec tes proches, autour de vous; toutes les initiatives sont les bienvenues ! (tournoi sportif, tombola, vide-grenier, distribution flyers….)
https://facealinceste.fr/blog/evenement/j-organise-un-evenement-local
Pétition
LES TALIBANS CONTRE LES AFGHANES : DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
https://www.change.org/p/les-talibans-contre-les-afghanes-des-crimes-contre-l-humanité
Reprenant une initiative de féministes espagnoles, le Front féministe international, qui groupe 413 associations dans 7 pays, lance une pétition pour demander que les talibans rendent compte devant la Cour pénale internationale de leurs crimes contre les femmes et les filles d’Afghanistan.
Dans chaque pays, demandons à notre gouvernement d'entamer une procédure contre les talibans devant la Cour pénale internationale !
Cette pétition s’adresse à des Françaises. Si vous êtes d’un autre pays, adaptez le dernier paragraphe, et lancez votre propre pétition nationale.
Nous, femmes du monde entier, de tous horizons et de toutes professions, nous qui avons une voix, et les hommes qui s'associent à nous, sommes choqué.es et crions : « Il faut soutenir les femmes et les filles d'Afghanistan. »
Oppressions, violences et harcèlements constants : les Afghanes subissent une répression qui viole leurs droits humains fondamentaux. Leurs droits à être éduquée, à travailler, à se déplacer librement sont bafoués.
Les femmes et les filles afghanes ont besoin que leurs droits humains soient garantis.
Nous demandons aux autorités publiques de tous les pays et aux organisations internationales d'agir, de prendre des mesures pour faire cesser la violation des droits fondamentaux des femmes et des filles d’Afghanistan. Ces pratiques contre des femmes parce qu'elles sont des femmes constituent sans aucun doute un crime contre l'humanité en vertu de l'article 7 du statut de Rome créant la Cour pénale internationale. Comme l'a demandé le rapporteur de l'ONU, elles devraient être considérées comme un apartheid sexuel.
Nous demandons à la Cour pénale internationale de déclarer que le traitement des femmes et des filles afghanes constitue un crime contre l'humanité. Les responsables de la centaine de règles et d'édits qui oppriment les femmes et les filles afghanes doivent être traduits en justice.
Nous, femmes françaises, qui avons une voix et des droits, demandons par cette pétition au gouvernement français d'entamer une procédure devant la Cour pénale internationale, d’inciter la communauté internationale à condamner la violence institutionnalisée contre les Afghanes et à mettre en œuvre des mesures pour éradiquer cette violence et garantir les droits de toutes les femmes et de toutes les filles d’Afghanistan.
Notre solidarité avec Gisèle Pélicot
Procès des viols de Mazan : « Not all men »
https://www.50-50magazine.fr/2024/09/19/proces-des-viols-de-mazan-not-all-men/
« À partir du moment où son mari est présent, il n’y a pas de viol »
Depuis deux semaines nous suivons, horrifiés, le procès des viols de Mazan.
Les faits sont connus : une femme droguée pendant plus de 10 ans par son mari et violée par des hommes trouvés sur internet.
Dominique Pelicot est le premier des responsables de ces scènes d’horreur. Comment un homme peut-il être le bourreau de son épouse ?
Mais ce n’est pas le seul protagoniste. Ils sont plus de 70 autres hommes, dont 50 ont été identifiés, à être les acteurs de cette sordide histoire.
Ces hommes, nous aimerions qu’ils soient des monstres dont la vie ou le parcours les prédisposeraient à faire le mal. Ce n’est pas le cas.
Ces hommes sont ce que le patriarcat nous encourage à appeler “des bons pères de famille”.
Ces hommes ce sont des “Monsieur tout le monde” sans histoire et sans historique avec la Justice.
Ces hommes ne vivent pas en dehors de la société. Ils y sont même particulièrement intégrés. Ce sont des pères et des grands pères qui travaillent et sont mariés.
Nous nous attendions à voir des gangsters et ce sont finalement nos pères, nos frères et nos amis qui se retrouvent à la barre de accusés. Nous attendions des monstres. Nous avons face à nous des messieurs bien sous tous rapports.
C’est ce qui fait de ces viols de Mazan non pas un fait divers mais un fait de société.
Car les violences faites aux femmes ont cette particularité : les victimes comme leurs bourreaux sont des gens sans histoire.
Le courage de Gisèle Pelicot doit nous obliger à nous interroger sur ce patriarcat délétère et cette culture du viol qui rend possible l’inexcusable.
C’est cette idée d’inégalité si ancrée qui a permis à 50 hommes de se dire un matin devant leur miroir et après une nuit de viol sous anxiolytiques “ C’est pas si grave. J’avais l’accord de son mari”.
Nous sommes toutes et tous conscient·es que, si, c’est extrêmement grave.
Mais n’oublions pas que ces 50 hommes sont avec nous dans le métro, au bureau ou sur les bancs publics.
Ce procès est aussi, et peut-être surtout, celui de notre société. Cette société chacun·e de nous en fait partie et chacun·e de nous en est comptable. Chacun·e de nous peut la changer.
C’est ensemble que nous devons mettre fin à cette culture du viol et j’espère, sincèrement, que des voix d’hommes, des “Monsieur tout le monde” s’élèveront pour dire : Plus jamais ça.
Mathieu de La Souchère
19 SEPTEMBRE 2024
Procès des viols de Mazan :"notre société doit changer", les 6 arguments qui pourraient le faire entrer dans l'histoire
Yasmine Boutaba - 14/09/2024
Le procès de Mazan, qui se déroule actuellement, est qualifié par l’historienne Christelle Taraud comme un tournant. Elle souligne que ce procès représente une rupture avec les schémas habituels des affaires médiatisées de viols. Peut-on parler du procès de Mazan comme un procès historique ?
Voici les 6 arguments développés par Christelle Taraud, féministe et historienne française, auteur de 'féminicides, une histoire mondiale". Elle suit de près le procès des viols de Mazan, et nous aide à décrypter les raisons qui en font un procès rupture, qui laissera probablement une place dans l'histoire, alors qu'un appel à manifester pour soutenir Gisèle Pélicot est lancé pour ce samedi 14 septembre, dans toute la France.
Les particularités de l'affaire Pelicot
L’historienne Christelle Taraud note que "c’est un procès qui fait rupture avec ce qu’on a l’habitude d’entendre dans les affaires de viols très médiatisés". Cette affaire se distingue par ses caractéristiques uniques. En effet, "c’est une affaire de viols qui s’étend sur plusieurs années, les violeurs sont nombreux, c’est impressionnant".
De plus, le cas de sédation, où la victime était lourdement inconsciente durant les faits, ajoute une dimension particulière à cette affaire. Christelle Taraud explique que "souvent, il s’agit de viols conjugaux ou intrafamiliaux", mais ici, la situation est exacerbée par l’implication du mari et la création d’une dynamique de viol en ligne impliquant, au moins, 50 hommes.
La position de Gisèle Pelicot : une figure "très digne, très courageuse et radicale"
La posture de Gisèle Pelicot, est également remarquée par Christelle Taraud. La position de cette femme "très digne, très courageuse et radicale" qui refuse le huis clos et choisit d’exposer publiquement son vécu, est soulignée. Même si avant elle, d’autres femmes comme Gisèle Halimi ont également fait ce choix. Gisèle Halimi encourageait les victimes à refuser le huis clos pour ne pas porter la honte qui ne leur revient pas. Elle ajoute : "le fait de publiciser ces affaires, c’est un espace de pédagogie pour toutes les femmes".
"C’est important de dire que c’est un procès qui fait rupture. C’est, entre autres, dû au fait à la personnalité de Gisèle", résume Christine Tanaud. A cela s’ajoute que dans la grande majorité des procès qui vont aux assises, on ne voit pas les victimes parce que huis clos, or là n’est pas le cas. Il y a une forte identification d’une manière et d’une autre. "Ce n’est pas la première fois que ça arrive, mais elle a ce profil de femme d’un certain âge qui est bouleversant, puis on la voit, on l’associe à un visage."
La manifestation nationale du samedi 14 septembre : "finie la minute de silence, maintenant, il faut hurler"
La manifestation nationale qui a lieu le samedi 14 septembre autour de ce procès est aussi un sujet d’analyse. Christelle Taraud explique que "la manifestation participe de cela, elle va donner à voir ce peuple féminin très malmené".
A Marseille, la manifestation est prévue 15H, place de la Joliette.
Elle note : "La manifestation a aussi vocation à dire : nous ne ferons plus de minute de silence, maintenant, nous allons hurler, et peut-être que ça finira par rentrer dans les oreilles des gens. Il faut que nous changions la donne. Ce procès doit être une caisse de résonance que notre société doit changer."
Une réflexion sur les termes juridiques
Sur le plan juridique, Christelle Taraud évoque la réanimation du débat sur les définitions de viol et consentement. Cela a déjà le cas lors d’autres procès comme celui d’Aix, tient-elle à souligner. Le procès de Mazan pourrait être "le catalyseur des relations entre les hommes et les femmes. C’est un électrochoc, il va produire des choses bénéfiques". Celle-ci analyse le procès sous l’angle des relations hétérosexuelles et des dynamiques de pouvoir.
Elle explique que "la dimension d’écrasement des femmes, très ancienne, dans ce rapport dominant dominé" est mise en lumière. Elle souligne que cette affaire révèle une "appropriation du corps des femmes". Pour rappel, durant le procès, le mari, consentant, ne voyait pas le problème, tant que la femme ne consent pas, elle est sous contrôle". Cette affaire permet de "comprendre sur le monde hétérosexuel", offrant ainsi une perspective historique sur les relations de pouvoir.
Une couverture médiatique d’une grande ampleur
Au-delà des médias nationaux, plusieurs médias internationaux comme le New York Times ou la BBC ont suivi cette affaire, inéluctable. Christelle Taraud aborde également l’évolution de la couverture médiatique des affaires de viols.
Elle note qu'"aujourd’hui, je crois qu'il y a eu une prise de conscience, peut-être parce qu’il y a plus de femmes journalistes. Il y a un changement de traitement médiatique. On comprend qu’il faut faire attention aux mots, et au récit qu’on raconte. On sait que les médias sont un pouvoir et que ce pouvoir peut permettre une prise de conscience. Si on a un récit plus juste, on pourrait être une défense sans déni, ni agression."
La figure du monstre déconstruite
Enfin, Christelle Taraud discute de la notion de "monstre" dans le contexte des violeurs. Elle observe que cette figure permet de "laisser penser que les violeurs sont toujours les autres", alors qu’avec le procès de Mazan, on se rend compte, qu’effectivement, "ce sont des hommes normaux, sans aucune pathologie psychologique".
Elle affirme que le procès de Mazan est important pour "faire bouger les lignes" et changer cette perception. "Il y a aussi l'argument selon lequel les violeurs de femmes dans ce pays, c'est surtout une certaine catégorie d'hommes et pas d'autres, eh bien encore une fois l'argument tombe immédiatement, là, on les a tous."
Elle poursuit, "J'espère que ça va opérer un basculement historique. Aussi, ça nous engage à comprendre ce qu'est la sexualité dans le monde hétéro, et la pornographie qui prône la haine des femmes, et la misogynie qui continue de se répandre sur internet sans contrôle, donc c'est tout cela que ce procès exemplifie avec force, et peut-être qu'il s'agit d'un moment important pour remettre les compteurs à zéro et essayer de progresser ensemble vers quelque chose de respirable pour tous et toutes.
Camille Froidevaux-Metterie, sur les viols de Mazan : « Oui, tous les hommes sont coupables, coupables d’être restés des indifférents ordinaires »
TRIBUNE
Camille Froidevaux-Metterie - Philosophe
Ceux qui clament haut et fort ne ressentir « aucune honte » ne font pas la démarche de comprendre la réalité historique et culturelle qu’est l’enracinement du système patriarcal, souligne la philosophe dans une tribune au « Monde ».
Publié le 19 septembre 2024
Dans l’émission « C ce soir », diffusée le 12 septembre sur France 5, j’ai raconté comment, lors d’une conversation à propos du procès des viols de Mazan (Vaucluse), Laurent Metterie, mon mari, en était venu à me dire qu’il avait honte, en tant qu’homme, face à cette abominable affaire. Le lendemain, le journaliste Karim Rissouli postait une vidéo dans laquelle il reprenait mes propos et y ajoutait sa voix, affirmant que ce procès était pour lui, et pour bien des hommes, l’occasion d’une prise de conscience. Depuis, en réaction à mes publications et aux siennes sur les réseaux sociaux, un flux continu de messages exaspérés déferle, dans lequel des hommes clament haut et fort ne ressentir aucune honte.
Certains le font avec une hargne qui ne trompe guère sur leurs convictions masculinistes, mais d’autres, nombreux, prennent soin d’argumenter. Le fil rouge de leurs propos consiste à rejeter catégoriquement ce sentiment de honte au motif qu’ils ne seraient en rien « responsables » des agissements ignobles des accusés de Mazan. Il y aurait, d’un côté, une minorité d’hommes « malades », « dégénérés », « monstrueux », et, de l’autre, la majorité des hommes « normaux », « respectueux », « non violents ».
Il se trouve aussi des femmes pour surenchérir et relancer l’accusation qui fait des féministes des furies aigries détestant les hommes et se complaisant dans une posture victimaire. Il s’en trouve même certaines pour déplorer que #metoo sème la terreur et pour dire qu’écouter les victimes, à défaut de les croire, c’est déjà bien.
Résistance obstinée
Cette résistance obstinée m’incite à revenir sur la notion de honte qui est au cœur de la mécanique patriarcale et dont il s’agit précisément de renverser la logique aujourd’hui. Dans Femininity and Domination (« féminité et domination », Routledge, 1991, non traduit), la philosophe étatsunienne Sandra Lee Bartky qualifie la honte de sentiment lié au genre, non pas tant qu’il soit spécifique aux femmes, mais en ce qu’elles sont plus enclines à l’éprouver et de façon plus intense que les hommes. Définie comme une impression permanente d’inadéquation par lequel elles se sentent inférieures, imparfaites ou diminuées, la honte serait pour les femmes un véritable mode d’être-au-monde résultant de multiples processus de socialisation qui construisent, dès l’enfance et tout au long de la vie, un ensemble d’attitudes et d’opinions négatives à propos de soi.
Dans le cas des violences sexuelles, la honte atteint son paroxysme, puisqu’il s’agit de rendre publique une dévastation intime dans un contexte, celui de la culture du viol, qui retourne la charge sur les victimes en supposant qu’elles sont toujours plus ou moins responsables de ce qu’elles ont subi. N’étaient-elles pas trop court vêtues ? N’avaient-elles pas trop bu ? N’avaient-elles pas accepté ce rendez-vous ? Tant et si bien que, selon une enquête de victimation du ministère de l’Intérieur, seules 6 % des personnes victimes de violences sexuelles physiques ont porté plainte en 2022.
Si Gisèle Pelicot a choisi de refuser le huis clos, c’est parce qu’elle refuse de se sentir honteuse des sévices qu’elle a subis et qu’elle souhaite ardemment « que la honte change de camp ». Le procès de ses agresseurs, en plus d’être celui du patriarcat dans tous ses rouages, nous offre l’occasion de révéler la distance entretenue par les hommes vis-à-vis du phénomène récurrent des violences sexistes et sexuelles. Certains en prennent conscience et font l’effort de reconnaître qu’ils sont trop longtemps restés silencieux. D’autres, au contraire, s’indignent des amalgames et répètent à tous les vents « pas tous les hommes ».
En dépit de l’intense production d’outils pédagogiques (livres, podcasts, documentaires) ces dernières années, très peu d’hommes font la démarche d’essayer de comprendre ce dont il est question. Ils peuvent donc affirmer ne pas avoir honte puisqu’ils restent ignorants de cette réalité historique et culturelle qu’est l’enracinement du système patriarcal.
Celui-ci repose sur la définition immémoriale de l’existence féminine au prisme des seules fonctions sexuelle et maternelle, lequel socle fonde la domination masculine comme entreprise d’assignation des femmes à la disponibilité corporelle. Cette mécanique prend toute une série de formes qui se déclinent, de façon graduée, de la banale réflexion sexiste jusqu’au viol, qui en est l’expression paroxystique. Aucune différence de nature ici, mais une différence de degré renvoyant à une logique de continuum qui reste étrangère à la majorité des hommes.
Sortir de l’inaction
Aujourd’hui que le procès des viols de Mazan met au grand jour la permanence et la banalité des violences sexuelles, l’occasion est donnée aux hommes de sortir de leur silence et de leur indifférence face à des faits massifs que nous révélons sans discontinuer depuis une dizaine d’années. Que ceux qui n’ont pas honte et ne se sentent coupables de rien comprennent que leur innocence individuelle n’est pas un argument. Oui, tous les hommes sont coupables : coupables de refuser de s’éduquer pour comprendre la dimension systémique des violences sexuelles, coupables de ne pas prendre part à nos combats, coupables de ne pas avoir honte, d’être restés, jusque-là, des indifférents ordinaires.
Peut-être faut-il leur répéter que nous avons besoin d’eux, leur rappeler que nous attendons leurs engagements, les assurer que nous ne les accablerons pas pour être de mauvais alliés ? Car nous avons aussi une responsabilité, celle d’avoir trop souvent opposé notre méfiance et notre insatisfaction à ceux qui tentaient de nous rejoindre. Si le temps est venu pour les hommes de sortir de l’inaction, il est aussi venu pour les féministes de les accueillir. Aujourd’hui, nous leur disons, ayez honte, et faites de cette honte le moteur d’une implication quotidienne dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et sachez que, si vous êtes avec nous, nous ne serons jamais contre vous.
Camille Froidevaux-Metterie, philosophe et professeure de science politique, spécialiste de la pensée féministe. Elle vient de publier « Patriarcat, la fin d’un monde » (Seuil, « Libelle », 60 pages, 4,90 euros).
Dans la médiathèque de Remue Méninges féministe, on trouve :
La culture de l'inceste par Iris Brey et Juliet Drouar, ouvrage collectif, aux éditions Points féministe.
Inspirée de la formule « culture du viol », la « culture de l’inceste » invite à penser ce tragique phénomène en termes culturels et non plus, comme on le fait toujours, individuels. Car si les chiffres sont si élevés (une personne sur dix en France), c’est parce que l’inceste est une pratique inscrite dans nos normes sociétales et artistiques, qui le tolèrent voire l’encouragent. Ce livre se concentre alors sur le cœur du sujet : Quels sont les ressorts sociaux de l’inceste ? Un ouvrage urgent, vibrant, conçu à sept voix pour amorcer une réponse politisée et collective.
Autrice, journaliste, réalisatrice, Iris Brey est spécialiste de la question du genre et de ses représentations. Elle est l’autrice de Sex and the series et Le Regard féminin. Elle réalise la série Split en 2023 disponible sur France TV Slash. Juliet Drouar est thérapeute, activiste, artiste, chercheur sur la domination de genre et d’âge. Il a publié Sortir de l’hétérosexualité (Binge Audio éditions, 2021).
Les petites sorcières d'Anne-Fleur Multon,
Lecture et dédicace, samedi 28 septembre à 11h avec Anne-Fleur Multon autour des deux premiers tomes Les petites sorcières, romans pour les 7-9 ans paru aux éditions Sarbacane.
Violette and Co
52 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
Du mardi au samedi Librairie et café : 10h30 - 19h30
Les petites sorcières : Tildir la catastrophe, tome 1
Tildir n’est pas née dans n’importe quelle famille de sorcières, oh non ! Elle est la petite dernière d’une «Très Grande Lignée » où toutes les sorcières sont extrêmement douées ! Seulement à 10 ans, Tildir n’a toujours pas découvert son pouvoir magique ; elle, son truc, c’est la bricole. Un micro-ondes cassé, un sèche-linge en panne, hop hop hop, un coup de tournevis et le tour est joué. Mais ça ne peut pas durer : au Solstice d’Hiver, il est l’heure pour Tildir de quitter la maison pour explorer le monde et découvrir sa spécialité magique. C’est la tradition ! Alors, juchée sur son vélo mauve adoré, sa fidèle ratte Jupitère sur l’épaule, la petite sorcière part pour sa première grande aventure !
Les petites sorcières : Maud Champignon, tome 2
Maud Champignon est une petite sorcière dégourdie et très bien organisée, merci pour elle. Son pouvoir ? Retrouver les objets perdus. Alors qu’en arrive l’heure de l’Apprentissage, Maud sait déjà ce qu’elle compte faire : ouvrir son Agence de Détective Privé. Avec sa fidèle pie, Watsonne, à califourchon sur son balai, la sorcière part à la recherche d’une affaire. Ça tombe bien : le sabre du khalife Oumar Tall a été volé au musée. Maud et Watsonne mènent alors l’enquête. Oui mais voilà : à qui appartiennent les oeuvres, dans les musées ? Les voleurs sont-ils toujours les « méchants » ? Maud va être confrontée à ces questions quand, une fois l’objet « retrouvé » et « rendu », il dégagera encore des vibrations magiques d’objet « perdu ».
Anne-Fleur Multon est née en 1993. Après des études de lettres où elle travaille sur la littérature de jeunesse et le genre, elle décide de se consacrer pleinement à l’écriture. C’est pour elle autant une passion dévorante qu’un moyen d’aborder avec les ados les problématiques qui lui sont chères. Féministe convaincue, et bookworm assumée, ses romans sont à son image : vivants, tendres, et ancrés dans leurs temps. Elle est l'autrice de Allô Sorcières, Il était une Autre fois et Les Nuits bleues. La série Les Petites Sorcières est sa première collaboration aux éditions Sarbacane.
A paraître en décembre :
SI UNE FEMME VEUT AVORTER, NE LA LAISSE PAS SEULE ! DU MLAC au centre IVG de Colombes. Martine Lalande, Catherine Soulat
Editions Syllepse, Collection : « Avant-première »
Le centre
IVG de Colombes a ouvert en 1975 juste après le vote de la loi, grâce au MLAC
de Gennevilliers. Des soignant·es et des femmes qui ont participé à sa création
racontent cette histoire, la lutte pour la loi, les avortements faits par le
MLAC puis l’ouverture du centre IVG.
Cinquante ans ont passé, le centre IVG a évolué, que reste-t-il de l’héritage
du MLAC? Les équipes de soignant·es ont changé, les locaux se sont agrandis, il
y a eu des aléas dans la vie de ce lieu, et des expériences novatrices
Les plus anciennes témoignent de ce qu’elles ont voulu transmettre, les plus jeunes de ce qu’elles reconnaissent comme « esprit militant » dans ce centre. Pour l’avortement comme pour la contraception, les femmes décident. Le pouvoir médical doit s’effacer pour laisser place à la recherche des meilleures conditions d’accueil et de réalisation de ce droit acquis par la lutte. Les différentes personnes interrogées fournissent les ingrédients qui rendent cet accueil possible. Elles s’inquiètent aussi pour son avenir.
Aujourd’hui de nombreux centres IVG ferment, tandis que l’avortement médicamenteux se développe. Va-t-on revenir à une situation où les femmes doivent assumer seules la douleur et la peur des complications de leur avortement? La question de lieux spécifiques et adaptés pour avorter reste cruciale.
A paraître en février 2025 :
ELLES AVAIENT FUI FRANCO. Marie-José Nadal
Editions Syllepse, Collection : « Des paroles en actes », 18€
Y a-t-il un intérêt à rendre compte, en 2024, de l’expérience de femmes qui ont fui l’Espagne au moment de la victoire de Franco en 1939? C'est à travers des récits de vie, des trajectoires de trois femmes, que ce livre entend contribuer à une compréhension toujours à renouveler du fascisme, des résistances au quotidien, des processus de violence. Ainsi, la première partie du livre met en perspective les récits en posant un cadre historique. La deuxième présente le témoignage de trois femmes espagnoles qui avaient refusé la victoire du général Franco en 1939 et s’étaient réfugiées en France en l’absence de leur mari. Cette séparation était due au fait que la frontière entre la France et l’Espagne avait été ouverte aux civils et aux blessés à partir du 27 janvier 1939, alors qu’elle était restée fermée aux soldats de l’armée républicaine espagnole jusqu’au 5 février 1939. Les trois narratrices, qui ont accepté de raconter leur vie à l'auteure, 50 ans après la défaite républicaine, étaient issues de familles dont les hommes avaient été des militants ou des sympathisants de partis politiques opposés au coup d’État nationaliste. Leur enfance et leur adolescence se sont passées à Barcelone, avec son lot de conflits sociaux et de répression. Leurs témoignages montrent comment des ouvrières ou des mères de famille des quartiers ouvriers se sont senties concernées par les idées nouvelles et par les changements politiques intervenus dès leur jeunesse. L’imprégnation politique émanant du milieu familial et de la vie de quartier alimente le sentiment d’appartenir à une classe sociale qui lutte pour améliorer ses conditions de vie. Dès lors, les femmes n’hésitent pas à intervenir à leur manière dans leur quartier. Ce sont les petits gestes de solidarité ou de rejet, les échanges verbaux dans les magasins, les coopératives d’alimentation, les lavoirs publics ou le récit de leurs loisirs dans les centres communautaires, qui révèlent la constitution d’un espace politique qui ne s’exprime que lors d’événements particulièrement importants comme les grèves, la célébration de l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement républicain, la guerre ou l’exil.
Pour ces trois femmes, leur décision de quitter l’Espagne représente leur fidélité idéologique à leur condition de femmes du peuple, en même temps qu’elles se sont montrées solidaires des choix politiques de leur famille, de leur milieu social et de leurs époux impliqués dans la guerre civile.
A paraître en novembre :
APPRENDRE ENSEMBLE. Une pédagogie de l'espoir. bell hooks
Ed. Syllepse, Collection : « Questions féministes »
La pédagogie de l’émancipation défendue dans cet ouvrage insiste non seulement sur l’importance du féminisme dans les salles de cours mais aussi sur la nécessité d’articuler la théorie et la pratique dans la lutte féministe afro-américaine.
bell
hooks nous rappelle qu’il existe un important corpus de textes qui nous aident
à mieux comprendre comment les différents systèmes de domination fonctionnent à
la fois de manière indépendante et interdépendante, pour perpétuer et soutenir
l’exploitation et l’oppression.
En s’appropriant ce point de vue, de nombreuses personnes ont changé
significativement leur mode de pensée pour transformer leur vie: les Blancs ont
travaillé à devenir antiracistes, les hommes à remettre en question le sexisme
et le patriarcat et les hétérosexistes à réellement défendre la liberté
sexuelle.
De fait, de nombreuses étapes, parfois imperceptibles, ont marqué ces évolutions. Afin de les valoriser, il faut les nommer tout en continuant à les critiquer rigoureusement. Ces deux choses, nommer le problème et l’articuler pleinement et profondément aux pratiques pour aborder et trouver des solutions, sont nécessaires pour générer et inspirer un esprit de résistance permanent.
Au travers de seize leçons, bell hooks présente l’éducation progressiste comme une pratique de la liberté qui permet de faire face au sentiment de perte de sens et de restaurer les relations entre les individus et entre les groupes.
En définitive, c’est ce qui peut conduire à apprendre à créer du commun, apprendre ensemble. Elle nous invite, en nous livrant les outils pour le faire, à mettre en œuvre une sagesse pratique visant à concevoir la salle de cours comme un lieu thérapeutique et révélateur, un lieu de libération mutuelle où l’enseignant et l’étudiant travaillent en partenariat.
Pointer l’inégalité, en se passant d’envisager un objectif constructif de résolution, empêche l’espoir et la création d’une société fondée sur la justice. Ce qui ne peut que contribuer à maintenir une culture de domination.
POP-PORN, LA BD QUI REMET LE PORNO À SA PLACE
Ecrit par Clara Authiat 5 septembre 2024
La pornographie est consommée par des enfants de plus en plus jeunes. « Pop Porn, le porno c’est pas la vraie vie ! » prévient sur ses dangers sans pour autant faire la leçon à celles et ceux qui en regardent. Une BD honnête et ludique pour décomplexer les discussions autour de la sexualité entre enfants et parents.
La Syrienne Noura Ghazi raconte son combat pour les droits humains dans une Syrie pacifiée
https://www.50-50magazine.fr/2024/09/19/noura-ghazi/
La syrienne Noura Ghazi est avocate, militante pour les droits humains, la paix et la justice, spécialisée dans la lutte contre les disparitions forcées et les détentions arbitraires. En 2018, elle a été nommée par Amnesty International comme l’une des 8 militantes les plus influentes au monde, et on comprend pourquoi : Noura Ghazi est une source inépuisable d’inspiration pour toute une génération qui veut faire primer les droits humains et faire cesser les violences. Elle voit l’amour et l’espoir là où d’autres ont abandonné et elle rêve de retourner vivre dans une Syrie pacifiée.
Nos enfants, nous-mêmes : manuel de parentalité féministe.
Présentation le 26/09 à 19h30 : Paris (75) à la Librairie Violette and Co 52 rue Jean-Pierre Timbaud 75011.
ALERTEZ LES BÉBÉS !
Certes, le système capitaliste appliqué aux conditions de vie des vieux dans les EHPAD, c'est indigne, ça provoque de la maltraitance, c’est insupportable. Mais qu'en est-il pour les bébés ?
« Les Ogres », enquête sur les dérives des crèches privées
Le Monde 15 9 24
Victor Castanet, auteur des « Fossoyeurs », sur le business du grand âge, s’est plongé dans l’universde la petite enfance avec son livre « Les Ogres », à paraître le 18 septembre chez Flammarion.
Partant des infractions constatées au sein du groupe People & Baby, il met en lumière les déviances d’un système irrigué par l’argent public. L’histoire débute (...) à l’été 2018. (...) En pianotant sur Internet, Zohra repère une crèche privée, située à quelques centaines de mètres seulement de leur future maison, à Villeneuve-d’Ascq [Nord].L’établissement – Baby City – appartient au groupe People & Baby dont elle ne sait alors presque rien, si ce n’est qu’il s’agit de l’un des géants du secteur. « (...) « Lorsque vous appelez, vous ne tombez pas sur la crèche, mais sur une commerciale du siège, m’apprend-elle. Cette vendeuse a alors raconté que ça allait être très compliqué, qu’il n’y avait plus aucune place, que la crèche était complète. » Après avoir soufflé le froid (...), la commerciale passe au chaud. « Elle nous demande ce qu’on fait dans la vie avec mon mari Bilal, poursuit Zohra. Je lui explique qu’on est médecins libéraux. Et là, elle s’écrie : “J’ai peut-être une solution pour vous ! Je peux vous avoir une place si vous prenez un berceau d’entreprise. C’est 14 000 euros par an. Mais au final, ça ne vous coûtera presque rien. C’est défiscalisable via le crédit d’impôt famille.” »La représentante de People & Baby profite d’une zone grise dans la réglementation.
Normalement, comme leur nom l’indique, les « berceaux d’entreprise » sont financés par des entreprises au profit de leurs salariés. Celles-ci doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés et pourront bénéficier, in fine, de déductions fiscales approchant les 80 % de la somme dépensée. En l’espèce, la situation est bien différente : Bilal n’est pas salarié d’une entreprise mais associé d’un regroupement de médecins. Les parents se retrouveront à régler eux-mêmes la part famille (les heures de présence de l’enfant) et la part entreprise (la réservation du berceau). Plus problématique encore, ils ne pourront pas légalement bénéficier de l’ensemble des déductions fiscales promises par People & Baby. (…)
Quelques semaines plus tard, la famille (...) s’installe dans le quartier de la Haute-Borne. (...) Ils en profitent pour discuter avec la directrice ; le courant passe instantanément. Laurie Renard leur laisse entendre qu’ils se sont vraisemblablement fait duper. « Elle ne comprend pas pourquoi on nous a obligés à prendre un berceau d’entreprise à 14 000 euros par an, rapporte Zohra, dépitée. Elle nous dit : « Mais vous auriez dû m’appeler. Je vous aurais pris en direct. La crèche est en train de redémarrer. Elle est quasiment vide. On n’a personne pour le moment. » (...) En discutant avec l’équipe, Zohra apprend que la crèche faisait précédemment partie du réseau 1,2,3 Soleil, avant d’être rachetée, peu avant leur arrivée, par le groupe People & Baby : « Ce n’était pas encore une crèche imprégnée par la mentalité People. »(...).
Une nouvelle directrice, Clémence Fournier, a remplacé Mme Renard, sans que les parents soient tenus au courant. Pur produit People & Baby, Mme Fournier enchaîne depuis 2018 les postes de direction au sein du groupe (...). A Villeneuve-d’Ascq, elle ne tarde pas à imposer sa méthode. Alors que les restrictions d’accueil et de circulation dans les crèches sont levées pour toute la France en octobre 2020, elles se poursuivent pendant encore plusieurs mois dans cette structure. Au grand dam des parents. « Elle barricade totalement notre crèche », déplore Zohra, qui n’y met plus que ses jumeaux, Sofiane et Younès. (…). La famille commence à avoir de sérieux doutes. (…). L’ambiance avait changé. Les filles avaient l’air triste. (...)« Il y a eu une demi-douzaine de démissions en quelques mois, raconte Zohra. Et à chaque départ, on a passé unpalier. ». Les jumeaux, eux aussi, se mettent peu à peu à changer de comportement. « Younès est de plus en plus effacé. Chacun son caractère, mais quand même. Il perd sa curiosité. Il joue moins.Il est trop sage, détaille sa mère. Pour ce qui est de Sofiane, ça devient très compliqué parce qu’il commence à hurler la nuit, à faire des cauchemars. Il ne peut plusdormir dans sa chambre. Il reste accroché à moi tous les soirs. Et le matin, il se roule par terre lorsqu’on le dépose à la crèche. » Et puis Sofiane a maigri. Elle l’emmène alors chez le médecin, qui lui recommande d’enrichir ses repas.Les premières frictions avec la nouvelle direction ont lieu à la fin de l’hiver 2020-2021. « Un matin,je vais pour déposer mes enfants à la crèche, me raconte Zohra, et là, il y a deux filles (...) qui sont au bout de leur vie. Elles pleurent et m’expliquent que tout le monde a la gastro, que la directrice n’est pas là, qu’elles ne sont que deux et qu’elles n’ont aucune visibilité sur le reste de la journée. Elles me supplient de reprendre mes enfants. » Zohra s’exécute mais demande des explications à la directrice. Une première passe d’armes oppose les deux femmes, notamment à propos de la facturation. Mme Fournier envisage, dans un premier temps, de lui comptabiliser la journée, arguant que la crèche était ouverte. (…). Peu après, sans qu’on puisse établir de lien de causalité, Zohra se met à recevoir de plus en plus régulièrement des remarques à propos du comportement de Sofiane, qui n’a pas encore 2 ans. (…). Zohra a le sentiment que la directrice a pris Sofiane pour cible et qu’elle ne lui laisse rien passer. (...) Un soir, Mme Fournier l’accueille ainsi : « Alors, vous venez chercher la crapule ? »(...)-
En mai 2021, la situation au sein de la crèche Baby City se dégrade encore, jusqu’à atteindre un point de non-retour. Le 25, aux alentours de 18 h 30, Zohra arrive pour récupérer ses jumeaux. L’infirmière, Sandrine, l’entreprend vivement. « Elle semble être dans une colère noire et me fait comprendre, avec une voix chevrotante, que mon fils est ingérable et qu’elle a dû lui expliquer les choses à cinq reprises, mais qu’il ne veut rien entendre », rapporte Zohra. Lors du dîner, elle constate des traces de griffures à la base du cou de Sofiane, juste en dessous de ses boucles brunes. (…). Deux jours plus tard, (...) en lui faisant prendre le bain, Bilal découvre des traces de bleus et de griffures sur l’épaule, le haut du bras droit et la base du cou de Sofiane. En observant attentivement le contour des marques, les deux parents médecins en arrivent à la même conclusion : « C’était la forme d’une main d’adulte, m’indique Zohra. Et ça faisait penser à des lésions d’empoignement. »(...). Dans la foulée, une enquête est diligentée par la brigade des mineurs de Lille. Plusieurs familles sont entendues. (...) Au total, neufs enfants au moins auraient été victimes de comportements inappropriés.
La directrice et l’infirmière sont poursuivies pour des « violences physiques ou psychologiques commises sur des enfants en bas âge » ainsi que des « privations d’aliments ou de soins au point de compromettre la santé d’un enfant ». Les faits signalés s’étalent sur une période allant de septembre 2019 à mai 2021. Les victimes supposées avaient entre 4 mois et 3 ans.
Soyons clairs : il existe des « brebis galeuses »(...). Le tout est de savoir comment les groupes réagissent en leur présence. En l’occurrence, lorsque des familles ou des salariées ont tenté d’alerter le siège de People & Baby, elles se sont heurtées à un mur de silence. (...) Plus grave, les auxiliaires de puériculture qui ont tenté de tirer la sonnette d’alarme ont été sanctionnées. (…). Le drame de Lyon le 22 juin 2022, vers 7 h 40, le père de Lisa dépose sa fillette de 11 mois à la micro-crèche Danton Rêve, dans le 3e arrondissement de Lyon. Myriam, agent de puériculture, l’accueille avant de retourner à ses activités. Cette femme de 27 ans est arrivée en retard. Elle est donc contrainte de faire le ménage en compagnie de ce premier bébé, passant d’une salle à l’autre. Ce matin-là, la direction de People & Baby l’a laissée ouvrir seule. La réglementation l’y autorise. La crise due au Covid a temporairement assoupli les règles : c’est seulement à partir de l’arrivée du quatrième enfant que la présence d’une seconde professionnelle est obligatoire. (…).
Quelques minutes plus tard, deux mamans entrent dans la crèche. Myriam, paniquée, les entraîne jusqu’à Lisa, allongée au sol, prise de convulsions. Les pompiers, aussitôt alertés, transportent le nourrisson à l’hôpital Femme Mère-Enfant. A midi, le décès de Lisa est constaté. Aux secours, Myriam a raconté que la fillette a avalé de la gouache. (...) Elle passe finalement aux aveux quarante-huit heures plus tard, au cours de sa seconde garde à vue. L’agente de puériculture reconnaît alors avoir forcé Lisa à ingérer du « déboucheur W.-C. », « excédée par ses pleurs », expliquant, selon ses propres mots, « avoir pété un plomb ». (…).
Christophe Durieux, le président du groupe, et ses équipes rapprochées répéteront à l’envi que ce drame est un acte isolé, commis par une professionnelle en dehors de tout soupçon, que l’organisation de l’entreprise ne saurait être questionnée (…). J’apprends (...) que quelques mois avant ce drame, en février 2022, l’autrice de l’homicide, Myriam, a été embauchée par l’un des concurrents de People & Baby, le groupe Babilou (...). Ce groupe lui a fait signer un CDD le 21 février, avant de mettre fin à sa période d’essai... au bout de cinq jours seulement !
Des conditions de travail déplorables
J’ai obtenu les témoignages inédits de deux anciens cadres du groupe, dont la mission était précisément d’assurer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de People &Baby. Si l’un d’entre eux a préféré rester anonyme, le second a décidé de témoigner en son nom. Il s’appelle Frédéric Heuze et a occupé ce poste en contrat d’alternance entre septembre 2021 et mars 2022. Il avait notamment la charge de la mise en place du plan de maîtrise sanitaire, du contrôle de la qualité de l’air, de la formation incendie, et plus globalement du développement d’une politique de sécurité pour les 630 crèches du groupe ainsi que les sièges régionaux.« Il y a certaines entités du groupe où l’on devait faire des audits de sécurité, or on n’a jamais réussià aller sur place, me révèle Frédéric Heuze. Dès que l’on proposait des dates, ça n’allait pas. (...) ». Il ira même jusqu’à préconiser à certains de ses collègues d’alerter les autorités de contrôle. (…). Son collègue, que nous appellerons Michel Meunier, partage la même analyse. (...) : « Je me suis rendu compte que des agents de puériculture faisaient plus de huit heures d’affilée avec les enfants, sans pause. (...) ». Frédéric Heuze comme Michel Meunier sont partis peu de temps avant le drame de Lyon, avec le sentiment de ne pas pouvoir accomplir la mission pour laquelle ils avaient été embauchés. « J’ai fait un abandon de poste après avoir tapé, vainement, du poing sur la table, dégoûté par leurs pratiques, précise M. Meunier. (...) Je me suis rendu compte qu’en fait mes rapports servaient avant tout à obtenir des subventions publiques pour réaliser des travaux dans les crèches. Et qu’une partie de cet argent n’était pas dépensée. C’est un montage très sophistiqué... » (…). Aucune région ni aucun type de crèche ne semblent épargnés.
En 2022, le groupe a eu à affronter une grève de ses employés, à Dijon. Une vingtaine de professionnelles, sur la trentaine que compte l’établissement Roosevelt (80 berceaux), décident de stopper le travail le 21 février. Sous couvert d’anonymat, elles racontent à France 3 Régions la dureté de leur quotidien. « Nous avons un problème récurrent de chauffage. Certains matins, la température dans les locaux oscille entre 11 C et 15 C. Nous avons des soucis réguliers avec la machine à laver, le four ou le stérilisateur. Des matelas sont défectueux, arrachés... » La mairie, embarrassée, révèle avoir déjà dû intervenir, quelques mois plus tôt, pour la remise en marche du chauffage. Roosevelt n’est pas une crèche d’entreprise mais une délégation de service public (DSP), confiée par la ville de Dijon à People & Baby. (…) : « Le jackpot » !
Il va être ici question d’argent public, donc de notre argent à tous. Afin d’inciter les entreprises à réserver des places de berceaux pour améliorer l’équilibre vie privée-vieprofessionnelle de leurs salariés, l’Etat a mis en place, en 2004, le crédit d’impôt famille (Cifam). En l’état actuel de la réglementation, il permet aux sociétés de déduirede leurs impôts 50 % du prix du berceau. Ce à quoi il faut ajouter 25 % de déduction de l’impôt sur les sociétés. Cette niche fiscale est, bien évidemment, lepremier argument de vente développé par tous les vendeurs du secteur (...). Sans ce dispositif, le secteurs’écroule. Pour ne pas voir la note s’envoler de manière totalement incontrôlable, l’Etat a posé des garde-fous. Par exemple celui-ci : une entreprise ne peut obtenir plus de 500 000 euros de déductions via le Cifam. Le cadre paraît, à première vue, bien défini (...). C’est sans compter, là encore, sur l’ingéniosité de People & Baby, d’après les témoignages de nombreux cadres. (…). Le hic, c’est que personne n’a pensé à fixer un plafond par prix de berceau. Un oubli que People n’a pas tardé à exploiter. (...) La stratégie était bien réfléchie : cibler les beaux quartiers, où les loyers sont chers et où l’on trouve des profils aux rémunérations conséquentes, tels que les avocats, les médecins, les notaires, etc. (…). Il était alors possible d’exploser les tarifs des berceaux, ce que m’a confirmé l’ancien directeur commercial, Alain Moresco. « Sur ce secteur des crèches d’entreprises, on était 30 % plus chers que nos concurrents, affirme-t-il. (...) Pour People, c’est évidemment le jackpot. Pour les finances publiques, c’est une tout autre histoire. (...) »
Le secret de la fortune des Durieux
Pendant des mois, j’ai avancé à l’aveugle.Je ne parvenais pas à comprendre le sens de la trajectoire de People & Baby, je me demandais pourquoi une personnalité comme Christophe Durieux se battait avec tant de vigueur pour faire grossir un groupe non rentable. Et puis un jour (...), les pièces du puzzle se sont enfin assemblées devant moi. (...) Même quand le groupe People & Baby affiche un déficit, le couple dirigeant s’enrichit, à travers ses SCI, en se constituant un patrimoine immobilier. (…) Mais qui donc arrêtait les prix de ces loyers ? « Eux-mêmes ! s’exclame l’ancien [directeur général adjoint] de People & Baby, Bruno Simon. (...) »
On commence à comprendre le mécanisme. Christophe Durieux et son épouse Odile Broglin sont les détenteurs d’un groupe dont la majorité des revenus provient de l’argent public. Ils acquièrent, via leurs SCI, des locaux qu’ils louent ensuite à leur entreprise. Les loyers ne sont pas, a priori, établis en fonction du marché locatif mais d’après le montant de leurs échéances de crédit. Ce procédé n’a rien d’illégal, à condition que le loyer ne soit pas surévalué (...). En résumé, l’argent sort de People & Baby pour rejoindre les sociétés du couple fondateur. (...).
« Du point de vue de l’actionnaire, le loyer du siège payé trop cher, c’est de l’argent qui sort de sa poche, m’explique-t-il. Alors que le loyer de la crèche, c’est de l’argent qui sort de la poche de l’Etat. » (…) Au cours de nos échanges, ChristopheDurieux a reconnu, à demi-mot, qu’il arrive que le montant des loyers soit fixé en fonction d’autres critères que la valeur du marché. « Il faut quand même qu’on soit dans un financement cohérent, justifie-t-il. (...) Mais notre calcul, on le fait en fonction de la rentabilité pour l’exploitant People &Baby. (...) Nous, ce qu’on veut, c’est de la marge pour People & Baby. » Le hic, c’est que de la marge, People & Baby n’en a jamais. Et que, dans le même temps, le patrimoine immobilier du couple fondateur grossit chaque année.
Le triomphe du low cost(...)
Le tournant remonte à vingt ans. Le monde de la petite enfance a été totalement bouleversé en 2004 par la politique volontariste de Christian Jacob, alors ministre de la famille. Face au manque criant de berceaux, il a pris la décision de « booster » le secteur en instaurant des subventions de financement aux opérateurs privés ainsi qu’une déduction fiscale aux entreprises souhaitant proposer des places à leurs salariés. C’est à la même période qu’est né le principe de la délégation de service public (DSP), lorsqu’une mairie (ou une collectivité) confie à un groupe privé la gestion d’une crèche municipale existante ou en projet (...). Un certain nombre de maires ont jugé judicieux de faire appel à des sociétés dont la petite enfance était le cœur de métier. Cela leur permettait également de réduire sensiblement les délais d’ouverture. Alors qu’une mairie, soumise au code des marchés publics, met entre trois et cinq ans pour créer une nouvelle structure, les gestionnaires privés sont capables d’être opérationnels en moins de six mois. Autre avantage non négligeable : la réalisation d’économies sur le budget communal.(...). Le tarif du berceau, dans ce fonctionnement, tourne alors autour des 7 000 euros annuels, tandis qu’en gestion directe il leur fallait bien souvent dépenser plus de 10 000 euros, du fait notamment de ce mal endémique propre à la fonction publique, l’absentéisme. (…)
A priori, si le privé réduit ses marges et permet aux communes d’économiser de l’argent public, c’est plutôt une bonne nouvelle. Mais les choses ne se passent pas ainsi. Car en réalité, en dessous d’un certain prix, il n’existe que deux options : soit le gestionnaire voit sa rentabilité diminuer au risque de mettre en péril son avenir ; soit il baisse la qualité de ses prestations : c’est ce qu’on appelle le low cost.(...) Et voilà comment la guerre des prix déclenchée aux alentours de 2010 dans le secteur de la petite enfance a entraîné une diminution du nombre de professionnelles dans de nombreuses crèches. Or, moins de personnel signifie des conditions de travail et une qualité d’accueil des bébés dégradée. Partout en France, des communes, petites ou grandes, de gauche ou de droite, font le choix du moins cher (...). Il se trouve que l’une des toutes premières lanceuses d’alerte de cette enquête a été employée par l’une des crèches confiées par la mairie d’Aix-en-Provence à Le Petit Chaperon Rouge. Cette femme, désireuse de rester anonyme et que nous appellerons Samantha, (...) m’accueille avec trois de ses collègues. (…). Ces quatre professionnelles me racontent, avec beaucoup de détails, les conséquences concrètes de cette stratégie low cost, tant au niveau de la nourriture – « On doit désormais commander 5 % de repas en moins par rapport au nombre d’enfants inscrits » – que de l’occupation – « On a un système de surbooking, comme dans les avions, on inscrit des enfants en plus de notre capacité » –, des ratios d’encadrement – « Chez les grands, on doit gérer normalement huit enfants, et ça arrive qu’on en ait neuf ou dix, (...) » – ou du profil de certaines professionnelles (...).
Cette analyse, Jean-Emmanuel Rodocanachi, le fondateur de Le Petit Chaperon Rouge, la conteste fermement. Il est bien obligé de reconnaître que la dotation de la ville a baissé (de plus de 15 %) entre 2009 et 2022, mais il assure que le budget de fonctionnement global (...) a, lui, augmenté.
Même à Matignon...Cette dynamique du low cost ne concerne pas que les villes ou les collectivités, mais aussi des ministères ou de grandes entreprises publiques. (...) Mais j’ai découvert un cas encore plus emblématique : la crèche de... Matignon. (…). Le 4 juillet 2022, soit deux semaines après la tragédie de Lyon, les services d’Elisabeth Borne (...), ont fait le choix du moins-disant et du moins cher, optant pour la proposition offrant le moins d’effectifs à un prix par berceau compris entre 4 500 et 3 000 euros, en fonction du taux d’occupation. Rappelons (...) qu’une mairie dépense plus de10 000 euros en régie directe ou encore que les premières DSP étaient facturées autour de 7 000 euros... Et que les services du premier ministre sont désormais prêts à descendre jusqu’à... 3 000 euros ! (…)
Responsabilité des élus locaux
Les services départementaux de PMI (service de protection maternelle et infantile), qui ont la lourde tâche d’inspecter les structures d’accueil du jeune enfant, sont particulièrement pointés du doigt. (…). Une crèche est inspectée tous les deux ou trois ans environ alors qu’une maison de retraite, avant 2022, faisait l’objet d’une vérification approfondie tous les vingt ans en moyenne. Alors, qu’est-ce qui cloche ?
Un témoin essentiel entre en scène. (...)
Avocat, spécialiste du contentieux des autorisations, il forme depuis plus de six ans des agents de la PMI à l’inspection-contrôle. Il me dépeint, inquiet, une dégradation continue du niveau de ses « élèves ». (…). Mais selon les dires de ce formateur, le principal obstacle est à chercher du côté des élus locaux. (...)(...). Ce témoin me donne une (...) information, confirmée par deux autres sources. Dans le département des Hauts-de-Seine, les inspecteurs de la PMI auraient découvert, dans les années précédant le Covid, des dysfonctionnements d’ampleur impliquant plusieurs établissements de La Maison Bleue [un groupe privé revendiquant 3 000 crèches]. « Ils avaient repéré que les noms de membres du personnel apparaissaient sur l’organigramme de plusieurs crèches, révèle-t-il. On ne peut pas être dans deux endroits à la fois... Ils avaient également mis au jour un système d’optimisation des coûts, notamment au niveau du nombre de repas. » Une accusation fermement contestée par l’actuel PDG de La Maison Bleue. Les pratiques dénoncées par ce formateur auraient poussé la PMI à réclamer la fermeture de plusieurs établissements. « (...) Mais il ne s’est rien passé, s’indigne mon témoin. Et il n’y a pas eu de fermeture. Pourquoi ? « Parce que les élus ont besoin de places en crèche et savent pertinemment qu’il n’y a plus de pognon côté public. Alors ils vous font comprendre qu’il ne faut pas emmerder leprivé.»
Précarité magazine, 21/09/2024
Spectacles, expos, etc...
Femmes en résistance aux frontières : les 28 et 29 septembre à l’Espace Jean Vilar à Arcueil
Festival de films documentaires féministes
https://www.facebook.com/femmesenresistance/?locale=fr_FR
Deux documentaires
Les Silencieuses, un documentaire qui donne la parole aux femmes sans enfant
Le documentaire poignant de Nicole Zeizig, "Les Silencieuses", explore avec une grande sensibilité le parcours des femmes sans enfant dans une société où la maternité est souvent perçue comme la norme.
En donnant la parole à sept femmes qui, pour diverses raisons, n’ont pas d’enfants, le film interroge les attentes culturelles et sociales qui pèsent sur la féminité.
Dans ce film visuellement et émotionnellement riche, Nicole Zeizig pose une question fondamentale : que signifie être femme dans une société qui valorise autant la maternité ?
Un projet personnel et une thématique universelle
"Les Silencieuses" est un projet né de l'expérience personnelle de Nicole Zeizig, la seule dans une grande famille où tout le monde a des enfants.
La réalisatrice a souhaité interroger les attentes implicites qui pèsent sur les femmes concernant leur rôle reproducteur, illustrées par des termes comme "nullipare" – un mot effectivement assez froid et stigmatisant.
À travers ce film, elle cherche à déconstruire ces normes sociales qui définissent trop souvent la féminité par la maternité.
Je me suis toujours sentie décalée dans cette grande famille où tout le monde a des enfant
Nicole Zeizig
Réalisatrice du documentaire "Les silencieuses"
Nicole Zeizig explique : "En réalisant ce film, je voulais donner la parole à ces femmes invisibles, marginalisées par leur non-maternité." Ce désir de libérer la parole est au cœur du documentaire "Les Silencieuses", offrant un espace d'expression pour celles dont l’histoire est habituellement laissée de côté.
Témoignages intimes et diversité des parcours
Le documentaire se distingue par la profondeur et la diversité des témoignages qu’il recueille. Chacune des femmes partage un parcours unique, révélant les différentes raisons pour lesquelles elles n’ont pas eu d’enfants.
Certaines, comme Gaëlle, ont fait un choix conscient : "Je ne voulais pas faire d'enfants. [...] Mon parcours m’a permis de me réaliser professionnellement, mais cela ne m’a pas permis de construire une famille."
Pour d'autres, comme Chantal, la non-maternité est le résultat de circonstances personnelles ou de décisions prises dans des moments de grande confusion : "Je faisais tout pour que ça n'arrive pas. J'avortais, encore
et encore, car c'était impensable, insupportable, inimaginable avec cet homme-là à ce moment-là."
Ces témoignages sont fréquemment empreints de paradoxes émotionnels. Fred, par exemple, explique comment une grossesse non désirée et un avortement ont transformé sa manière de penser la maternité.
Cet avortement m’a obligée à réfléchir sur ce que signifiait être mère. Avant cela, je ne m'étais jamais posé la question. Gaële
Un documentaire visuel et sonore propice à la réflexion
La singularité du film réside dans le choix esthétique fort de Nicole Zeizig. En utilisant la langue des signes pour traduire certains témoignages, la réalisatrice met l'accent sur le corps et la gestuelle, qui deviennent des outils d’expression poétique et cinématographique.
La langue des signes amplifie les silences, faisant de l'absence de mots un élément central de l'émotion transmise. Lucie Lataste, Lila Bensebaa, Anabela Canica et d'autres comédiennes sourdes ou bilingues incarnent avec une grande sensibilité les récits de ces femmes.
En donnant la parole à sept femmes qui, pour diverses raisons, n’ont pas d’enfants, le film interroge les attentes culturelles et sociales qui pèsent sur la féminité.
Dans ce film visuellement et émotionnellement riche, Nicole Zeizig pose une question fondamentale : que signifie être femme dans une société qui valorise autant la maternité ?
Un projet personnel et une thématique universelle
"Les Silencieuses" est un projet né de l'expérience personnelle de Nicole Zeizig, la seule dans une grande famille où tout le monde a des enfants.
La réalisatrice a souhaité interroger les attentes implicites qui pèsent sur les femmes concernant leur rôle reproducteur, illustrées par des termes comme "nullipare" – un mot effectivement assez froid et stigmatisant.
À travers ce film, elle cherche à déconstruire ces normes sociales qui définissent trop souvent la féminité par la maternité.
Un documentaire visuel et sonore propice à la réflexion
La singularité du film réside dans le choix esthétique fort de Nicole Zeizig. En utilisant la langue des signes pour traduire certains témoignages, la réalisatrice met l'accent sur le corps et la gestuelle, qui deviennent des outils d’expression poétique et cinématographique.
La langue des signes amplifie les silences, faisant de l'absence de mots un élément central de l'émotion transmise. Lucie Lataste, Lila Bensebaa, Anabela Canica et d'autres comédiennes sourdes ou bilingues incarnent avec une grande sensibilité les récits de ces femmes.
Nicole Zeizig cherche ainsi à immerger le spectateur dans une atmosphère propice à l'écoute des récits. Le bruit de fond de la vie quotidienne est ainsi souvent remplacé par des moments de calme, laissant la place aux émotions qui émergent des témoignages.
Le silence joue également un rôle essentiel dans la narration.
Le silence, souvent plus parlant que les mots, fait écho aux émotions des femmes qui se livrent. Nicole Zeizig, Réalisatrice du documentaire "Les silencieuses"
Et d'ajouter "Il permet au spectateur de ressentir pleinement le poids des non-dits, des regrets, mais aussi des choix assumés." Cette approche immersive plonge le spectateur dans une atmosphère de réflexion, où chaque silence est une invitation à méditer sur les récits de vie partagés à l’écran.
Nicole Zeizig a voulu que chaque témoignage soit filmé dans des lieux publics, suggérant ainsi la présence discrète, mais réelle de ces femmes dans un monde qui ne les remarque pas toujours. Les plans séquences utilisés pour capturer les gestes et les expressions des comédiennes en langue des signes amplifient la force des récits.
Le poids des normes sociales autour de la maternité
À travers ces récits de vie, "Les Silencieuses" aborde la pression sociale qui pèse sur les femmes pour devenir mères. Françoise raconte un moment particulièrement marquant de sa vie, lorsqu’un gynécologue lui a déclaré qu'elle était "nullipare" : "Ce mot m’a fait l’effet d’un coup de poignard. J'ai ressenti une profonde tristesse, comme si ma valeur en tant que femme était diminuée."
Le film met également en lumière les contradictions que vivent certaines femmes. Anne, qui n’a jamais voulu d’enfant, se retrouve exclue des discussions et des préoccupations de ses sœurs, toutes devenues mères : "Je me suis sentie exclue de ce domaine de la maternité, et de celles et ceux qui avaient des enfants. [...] Nous ne vivions plus dans le même monde, nous n’avions plus les mêmes priorités."
Pour certaines, la question de la maternité est plus ambivalente, comme le décrit Alessandra : "Le désir d’enfant s’est atténué avec le temps, mais parfois, je me demande ce que cela aurait été de devenir mère. Comme si ce désir faisait partie d’un compte à rebours qui s’installe avec l’âge."
Le silence comme symbole de résistance et de réflexion
Un autre aspect central du documentaire est l'utilisation du silence comme outil narratif et symbolique. Pour Nicole Zeizig, le silence n’est pas seulement l’absence de mots, mais une forme de résistance face à une société qui attend des femmes qu’elles se conforment à des modèles de vie prédéfinis. Ce silence, qui habite de nombreuses séquences du film, est souvent plus éloquent que les discours.
Certaines femmes du documentaire, comme Chantal, parlent du silence qu'elles ont longtemps gardé autour de la question de la non-maternité : "Je n'ai jamais réussi à en parler avec personne, même pas avec un psy. C'est un paradoxe incroyable, parce que je ne me suis jamais projetée avec des enfants, mais en même temps, il y avait un amour pour ça... Un désir que je n'ai jamais pu accepter". Cette incapacité à verbaliser leur ressenti est un thème récurrent dans le film, révélant la pression sociétale qui rend parfois difficile l’expression de choix personnels.
Pour d'autres femmes, le silence est une façon de s’affranchir des attentes sociales. Patricia, par exemple, exprime une certaine sérénité dans son choix de ne pas avoir d’enfants, malgré les interrogations de son entourage : "À 40 ans, je me suis dit : ça va, je ne ferai pas d’enfant et je ne pourrai pas en avoir. [...] La liberté que cela m'a donnée est une chose dont certaines de mes amies mères étaient parfois jalouses."
Témoignages croisés : entre regrets et acceptation
Les récits recueillis par Nicole Zeizig montrent également que le rapport à la non-maternité est loin d'être homogène. Certaines femmes vivent cette absence comme une forme de deuil invisible, tandis que d’autres y trouvent une source de liberté. Françoise se souvient par exemple d’un moment clé de sa vie, lorsqu’elle a réalisé qu’elle ne serait jamais mère : "À 30 ans, j’ai commencé à vouloir des enfants, mais cela n’est jamais arrivé. Je me souviens d’avoir pris une photo de mon ventre et d’y avoir écrit ‘Place à prendre, place disponible".
De l’autre côté, Fred, bien qu’ayant toujours rêvé d’une grande famille, a fini par accepter que cela ne faisait pas partie de son destin : "À 40 ans, je me suis dit que c’était trop tard. J’ai rencontré quelqu’un, mais je lui ai dit dès le début que je ne ferais pas d’enfant. " Fred, comme beaucoup d’autres femmes dans le film, se retrouve dans une position ambivalente, où le désir d’enfant coexiste avec une certaine forme de paix intérieure.
Je n’ai jamais voulu faire un enfant seule, ce que je voulais, c’est une famille. Fred
Cette diversité de parcours est l’une des forces du documentaire, qui montre que la non-maternité peut être vécue de multiples façons. Fred, par exemple, n’a jamais ressenti le besoin de devenir mère, mais cela ne l’empêche pas de se poser des questions sur ce qu’aurait été sa vie si elle avait fait un autre choix : "Je me demande parfois ce que cela aurait été de devenir mère. Quelle mère j’aurais été ?"
La maternité, un choix ou une contrainte ?
Au cœur du documentaire se trouve une question universelle : la maternité est-elle un choix ou une contrainte ? Pour certaines des femmes interviewées, ce choix ne s'est jamais imposé de manière claire : "Je ne savais pas si je voulais des enfants ou non. [...] Après un avortement, j'ai commencé à me poser des questions, mais je n’ai jamais été certaine." Cette incertitude est un thème récurrent dans le film, illustrant le décalage entre le désir personnel et les attentes de la société.
D'autres femmes, comme Anne, ont ressenti une pression constante de leur entourage pour devenir mère, mais ont finalement choisi un autre chemin.
Mon entourage me disait souvent que je devrais faire un enfant, mais je ne voulais pas. J’ai préféré vivre ma vie en tant que femme, plutôt que de me consacrer à la maternité
Fred
Un miroir de la diversité des expériences féminines
Avec "Les Silencieuses", Nicole Zeizig offre un miroir révélateur de la pluralité des expériences féminines face à la maternité. Le film interroge les normes sociales tout en proposant une réflexion profonde sur les choix individuels et la liberté de les assumer.
À travers ces témoignages sensibles et nuancés des sept femmes, le documentaire nous rappelle que la maternité n’est ni une obligation, ni une fatalité, mais un parcours de vie parmi tant d'autres.
En brisant le silence autour de la non-maternité, "Les Silencieuses" ouvre la voie à une discussion essentielle sur la manière dont nous percevons et valorisons les choix des femmes dans notre société. Ce film choral, à la fois intime et universel, invite chacun d’entre nous à repenser la place de la maternité dans nos vies et dans nos représentations de la féminité.
Une avant-première à Nantes
Assistez à l'avant-première de ce documentaire le mardi 17 septembre à 20h à Nantes au cinéma Le Concorde, en présence de la réalisatrice et des personnes présentes dans le film. Venez nombreux (ses), c'est totalement gratuit.
Pour vous inscrire, c'est par ici.
"Les silencieuses", un film de Nicole Zeizig
Une coproduction À Perte de Vue / Les Films du Tambour de Soie / 24 Images / France Télévisions
Diffusion jeudi 19 septembre à 23 h
Rediffusion à 9 h 35 le vendredi 20 septembre, le lundi 23 septembre et le mercredi 2 octobre
À voir dès maintenant sur france.tv dans notre collection La France en Vrai
Diffusion d' "Une Française à Kaboul", dimanche 15 septembre sur France 5 à 23h (La case du siècle),documentaire écrit et co-réalisé avec M-P. Camus et Charlotte Erlih.
Il sera disponible ensuite en replay sur France Tv .
Première Française à avoir épousé un Afghan en 1928 et à s’être installée à Kaboul, Elizabeth Naim Ziai s’est battue toute sa vie pour l’émancipation des femmes dans son pays d’adoption. Son aventure méconnue permet de revisiter une époque où l’Afghanistan s’ouvrait, où le sort des femmes s’améliorait considérablement. Une note d’espoir, dans la noirceur actuelle que traverse le pays.
Frida
Mise en scène Paõla Duniaud
Frida retrace la vie trépidante de Frida Kahlo. Artiste peintre mexicaine du XXe siècle qui se distingue par son art provocateur et radical, son engagement politique en faveur du communisme, son esprit si libre et sa relation épique avec l’artiste Diego Riveira.
Enfant de la révolution mexicaine, elle a vécu une période de l’histoire tumultueuse et excitante ainsi que des dram s personnels. Victime d’un très grave accident de bus à 19 ans, elle aurait pu perdre la vie
Ce texte raconte son histoire personnelle mais aussi l’histoire d’une femme de son temps qui résonne clairement avec notre époque actuelle: Son rapport à l’amour déconstruit, sa bisexualité, son indépendance en tant que femme dans un milieu d’Homme et surtout, sa force. rida, par son ouverture d’esprit et sa liberté, a façonné une image indélébile et a laissé son héritage à toutes les générations futures. Son ambition brute et son charisme se devinent à l’intensité de son regard.
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi à 19H jusqu’au 30 novembre 2024 : Paris (75018)
Manufacture des Abbesses 7 rue Véron
Réservations tél : 01 42 33 42 03
Attachée de presse: Lynda Mihoub; Agence LM: 01 44.85.74.50 / 06 60 37 36 27/
Lynda@LagenceLM.com
Cabaret de Femmes pour une Noce / chant avec Claire Dubuisson
Samedi 19 Octobre De 15h à 18h au Palais de la Femme, 94 rue de Charonne, 75011 Paris
Durant 6 séances, vous rencontrerez des membres de l'équipe du spectacle "Cabaret de Femmes pour une Noce",mis en scène par Fanny Travaglino (Cie Eau IDA associée au Théâtre de la Girandole). Vous intègrerez les moments chantés de ce spectacle festif et engagé. Un cabaret qui est comme un bal, un banquet de fête, une noce. Pour ce faire, après des jeux de mise en voix-mise en corps, vous apprendrez 5 chansons arrangées et transmises par la chanteuse et cheffe de choeur Claire Dubuisson et vous créerez aussi deux nouveaux morceaux !
Ce projet a pour souhait de faire se rencontrer l'équipe du spectacle - 14 femmes de toutes générations et toutes cultures confondues- et le groupe formé à l'occasion du 22ème parcours filles-femmes autour de cet ensemble de textes inspirants d'autrices et de poétesses du monde entier...
Pour en savoir plus RDV le samedi 5 Octobre à 18H30 au Forum des associations du Palais de la Femme.
1er atelier d'une série de 6 les 19 Octobre / 30 Novembre /14 Decembre /11 Janvier / 8 février / 15 mars et représentation publique le week-end du 22 mars 2025 ouverts à toutes et tous sur iscription, et adhésion (10euros) à comitemetallos11@gmail.com, libre participation aux frais d'atelier.
Source : Comité Métallos 94 rue Jean Pierre Timbaud, 75011 Paris
Un jeu : RIEN À CACHER. POUR VOTRE SÉCURITÉ, ON VOUS SURVEILLE
Adrien FULDA & Luc DE BOIS
Citoyennes et citoyens, garantir votre sécurité est notre priorité. Nous avons mis en place un programme de surveillance pour détecter et sanctionner toutes les infractions. La grandeur de notre Nation dépend du respect des Législations. Nous comptons sur votre vigilance !
Ce que vous faisiez hier avec insouciance n'est plus permis. Réussirez-vous à jouer vos cartes sans être dénoncé·e ?
Rien à cacher est un jeu de bluff pour tout public.
1 Jouez vos cartes Liberté, face cachée
2. Surveillez vos adversaires et révélez leurs cartes interdites
3. Gagnez des jetons Individu modèle et renforcez les lois
Le jeu est fabriqué en Europe et illustré par Loïc Sécheresse. Il inclut un
livret de 24 pages.
De l'autre côté des caméras » rédigé par deux associations qui luttent contre la surveillance de masse et ses dangers pour les libertés : la LDH (Ligue des droits de l'Homme) et le Mouton numérique.
Ed. Coco Cheri, 2024, 18€

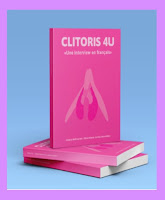
Commentaires
Enregistrer un commentaire