POUR ÉCOUTER L’ÉMISSION CLIQUEZ ICI
Notre invitée, Françoise Carraud, a coordonné le livre de récits « Viticultrices », paru aux Editions Dire le travail : « Saisonnières, cheffes d’exploitation, salariées ou conjointes de vignerons : treize femmes racontent leur travail dans la viticulture au jour le jour. Elles disent le plaisir et la pénibilité, leurs joies et leurs découragements, leurs préoccupations, les charges domestiques et les partages avec les hommes. » Échanges autour du livre et lecture d'extraits
Présentation de la coopérative Dire le travail - www.direletravail.coop
Informations militantes, médiathèque de Remue Méninges féministe, spectacles, expos, etc...
Lire tous les détails des informations ci-dessous
Musiques : "Frangines" Anne SYLVESTRE (indicatif début), « Les gens de la moyenne » Colette MAGNY« Dans nos chants », Catherine RIBEIRO « Quand les hommes vivront d’amour », NAOUAL « Swing ta vie », MAURANE « Quand l’humain danse », Claude NOUGARO Bidonville/Berimbau, MATHILDE « Guerrières de lumière », ANNE et EDWIGE des Entresorceleuses « Dans nos chants » (indicatif de fin).
Informations militantes
Les « livres bannis » aux USA depuis 2018. Résistance en Floride avec la librairie The Lynx créée par l’autrice Lauren Groff et Clay Kallman,. https://www.24heuresdulivre.fr/les-interdictions-de-livres-se-multiplient-en-floride-alors-lauren-groff-a-ouvert-une-librairie/
Plus de 5 100 livres ont été interdits dans les écoles de Floride entre juillet 2021 et décembre 2023 – le nombre le plus élevé du pays, selon PEN America.
https://www.harpersbazaar.com/culture/a45012950/banned-book-list
LA LOI ALLEMANDE SUR L'AUTO-IDENTIFICATION
Manifestation le 1er novembre devant l'ambassade d'Allemagne le 1er novembre 2024
Communiqué de presse du Front féministe international
En soutien aux féministes allemandes de l’initiative « Laissez les femmes parler ! » („Lasst Frauen Sprechen!“), des féministes françaises organisent devant l’ambassade d’Allemagne à Paris un rassemblement vendredi 1er novembre à midi, jour de l’entrée en vigueur en Allemagne de la loi d’auto-détermination (Selbstbestimmungsgesetz). Des manifestations auront lieu en même temps dans plusieurs capitales du monde dont Berlin.
Cette loi autorise les parents à modifier l'état civil de leur enfant dès la naissance et à tous moments ; toute personne âgée de plus de 14 ans sans autorisation parentale, peut se déclarer homme, femme, non-binaire ou divers, et ceux qui ne la reconnaîtront pas dans sa nouvelle identité sont passibles d’une amende.
Des conséquences dramatiques pour les femmes et les enfants. La loi faussera les statistiques et les quotas fondés sur le sexe.
Les femmes et les filles victimes de violences sexuelles n’auront plus la protection d’espaces sans hommes.
Les lesbiennes n’auront plus le droit de se réunir dans des espaces sans hommes, déjà harcelées et menacées par des hommes qui n'acceptent pas leur attirance pour les femmes.
Nous rappelons une évidence : le sexe est constaté à la naissance. Une personne peut changer de genre, d’apparence, mais non de sexe, réalité biologique inscrite dans chacune de nos cellules.
Nous, féministes du Front féministe international (424 associations dans 8 pays), rappelons que le sexe constaté à la naissance est immuable et que c’est à la société patriarcale, et donc machiste et sexiste de changer.
A côté de l’Ambassade d’Allemagne. Le rassemblement aura lieu au coin du cours la Reine et de l'avenue Franklin Delano Roosevelt (devant l'entrée du Jardin de la Nouvelle France),
3ème Salon des livres féministes "Délivrées" qui se tiendra à Paris du 8 au 13 novembre 2024 à la Halle des Blancs Manteaux 48, rue Ville du Temple à Paris.
Dans ce cadre, je vous remercie de noter la date à la date du Samedi 8 novembre 2024 à 17h au cours de laquelle le Réseau Féministe "Ruptures" animera la projection-débat du film "Béziers, l'envers du décor" de Daniel Kupferstein qui porte sur la gestion du maire de Béziers, proche du Rassemblement national. Un débat est organisé à l'issue de la projection, en présence du réalisateur et de Marc Plocki, animateur du Collectif Ripostes. L'entrée est libre.
Osez le Féminisme a le plaisir de vous convier à fêter ses 15 ans
le samedi 16 novembre à partir de 13h30 à la Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard 75006 Paris
Pour célébrer en beauté nos quinze ans de luttes féministes et vivre un moment de partage inoubliable, nous avons concocté un programme engagé et festif, qui saura vous surprendre et vous inspirer !
Prochain Amphi du MAGE Jeudi 19 décembre 2024, 17h30-19h30, Amphi Durkheim, Sorbonne
« Quelles pratiques féministes de la non-mixité ? »
Suite à la sortie de la controverse parue dans le n° 49/2023 de Travail, genre et sociétés
Coordonné par : Fanny Gallot (Upec, CRHEC, IUF) et Alban Jacquemart (Université Paris Dauphine, Irisso)
Attention : inscription obligatoire. Si vous souhaitez assister à cet événement, merci de vous inscrire en précisant votre nom et prénom ainsi que votre affiliation institutionnelle à l’adresse suivante :
mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr avant le lundi 16 décembre 2024.
La captation vidéo de l'événement sera rediffusée prochainement sur la chaîne YouTube du Mage
Solidarité avec Pinar Selek
Comme vous le savez, une nouvelle audience aura lieu le 7 février 2025 à Istanbul à l’encontre de Pınar Selek. Les juges de la 15e chambre du Tribunal criminel d’Istanbul, qui étaient en charge de son procès depuis l'annulation de son quatrième acquittement par la Cour Suprême de Turquie et qui ont ajourné par trois fois le jugement de ce 5ème procès, ont depuis été démis de leur fonction. De nouveaux juges ont été nommés pour statuer sur le sort de Pınar Selek. Ce changement est un tournant qu’il est encore difficile d’évaluer précisément, mais nous ne vous cacherons pas notre inquiétude. Le ton est en effet monté du côté du pouvoir policier turc, qui accusait en juin dernier Pınar Selek, et à travers elle l'université et la recherche françaises, d'avoir tenu une conférence "de l'organisation terroriste PKK" en avril 2024, une manipulation éhontée qui constitue une atteinte grave à la liberté académique des universitaires. La révocation des juges qui ont statué lors de la dernière audience (juin 2024) serait-elle liée à leur décision de ne pas se prononcer immédiatement sur cet élément fallacieux infamant et diffamatoire? Seule certitude : la situation est grave et requiert de notre part un engagement renouvelé et résolu.
Marqué par les guerres, ainsi que par un renforcement alarmant de l’extrême droite en France, en Turquie et en Europe, comme ailleurs dans le monde, le contexte politique appelle de notre part une action déterminée, à la hauteur des enjeux. Au-delà de la personne de Pınar Selek, qui nous est chère et avec laquelle nous nous solidarisons sans compter, il en va de la liberté d’expression, de pensée et de recherche qui sont au fondement-même de la démocratie, aujourd’hui menacée.
Nous commençons dès à présent à former la nouvelle délégation internationale de soutien, que nous voulons forte, déterminée et nombreuse, prête à assister à la prochaine et probablement dernière audience qui aura lieu le 7 février 2025 à Istanbul. Merci de nous indiquer si vous envisagez personnellement de faire ce déplacement en écrivant à justice@pinarselek.fr .
Ci-joint, vous trouverez un document de synthèse qui rend compte de la situation extrêmement préoccupante dans laquelle se trouve actuellement Pınar Selek. Nous serions heureu-x-s que vous le transmettiez à d’autres personnalités publiques du monde politique, scientifique, associatif, culturel et militant susceptibles de se mobiliser en solidarité avec Pınar Selek et de défendre ainsi nos droits fondamentaux.
Si vous avez des idées d’action, ne manquez pas de nous contacter : justice@pinarselek.fr .
Nous récoltons également des fonds, afin d’être à nouveau en mesure d’aider financièrement les collectifs et personnes qui nous le demandent, à se rendre à Istanbul le 7 février 2025. Réussir une nouvelle fois à former une importante délégation prête à assister à cette audience est essentiel pour empêcher un jugement arbitraire. Chaque geste et chaque soutien comptent. Même un petit don fera la différence : https://www.helloasso.com/associations/karinca/formulaires/1 .
Dons possibles également par chèques à l’ordre de « Silence » avec mention au dos : « Solidarité avec Pınar Selek » et à envoyer à Silence, 9 rue Dumenge, 69004 Lyon
Coordination européenne des comités de soutien à Pınar Selek
Colloque : transition écologique et genre, quelles transformations du travail ?
Rendez-vous à Lyon ou en visioconférence pour comprendre les liens entre évolutions du travail, différences de sexe et de genre, et transition écologique. Trois secteurs clés seront particulièrement abordés : agriculture, services à la personne et métiers verdissants.
Mercredi 6 novembre 2024 - 09:30 Jeudi 7 novembre 2024 - 17:30
La transition écologique nécessite de revisiter nos organisations de travail, en tenant compte des inégalités environnementales, sociales, professionnelles et de genre. Comment penser les transformations du travail pour mieux préserver à la fois la santé au travail des femmes et des hommes et les écosystèmes naturels ?
Le colloque explorera les évolutions du travail et les différences de sexe et de genre à la lumière des défis de la transition écologique dans trois secteurs professionnels / métiers :
• l’agriculture avec l’exploration de nouveaux modèles de production,
• les métiers de services face à la crise climatique,
• les métiers verdissants qui génèrent de nouvelles opportunités et contraintes dans les organisations.
Des regards croisés entre recherches et pratiques seront proposés.
Pétition à signer
POUR LES DROITS DES FEMMES MIGRANTES VICTIMES DE VIOLENCES, MOBILISONS-NOUS !
Aujourd’hui, en France, les femmes migrantes victimes de violences ne sont pas protégées, ni même écoutées ou encore crues. Il est temps d’agir, nous avons besoin de vous !
“Quand on est victime de violences, porter plainte est un droit"
Comme toutes les femmes, les femmes migrantes peuvent être confrontées à des violences. Mais en tant que femmes exilées, les violences qu’elles peuvent subir sont aggravées par la précarité de leur statut administratif en France.
« Elle ment pour avoir des papiers », « elles ont l’habitude d’être violées », « elle a voulu venir, c’est le prix à payer pour travailler/être hébergée » ,..Parce qu'elles sont étrangères, ces femmes qui subissent des violences ne sont pas considérées comme victimes : cette double violence doit cesser !
Pour les femmes qui ont obtenu un titre de séjour suite à leur mariage, elles devront, pour le renouveler, justifier des violences subies et prouver que la rupture de la vie commune est due aux violences conjugales.
Pour les femmes réduites en esclavage par un employeur ou exploitées sexuellement par un réseau ou un proxénète, seule une coopération avec la police leur permet de rester sur le territoire. Si elles ne s’engagent pas dans cette démarche, qui peut faire peur et les mettre en danger, elles ne seront pas régularisées.
Pour celles qui fuient les persécutions liées à leur genre (excision, mariage forcé, viol…), il faudra raconter encore et encore les atrocités subies.
Et si elles ne parviennent pas à convaincre les autorités, ce sera l’obligation de quitter le territoire pour elles !
Alors que les femmes représentent en France plus de la moitié des personnes migrantes, elles sont pourtant les grandes absentes des discours politiques et des textes de loi. Il est temps de contrer les discours simplistes et stigmatisants et ainsi agir pour des politiques migratoires plus protectrices et non discriminantes. Depuis 2003, plusieurs textes législatifs et réglementaires permettent de mieux prendre en considération la situation des personnes étrangères victimes de violences. Leur application n’est cependant pas systématique et ces textes restent encore insuffisants pour permettre à ces personnes d’une part, d’être efficacement protégées et d’autre part, d’accéder effectivement à leurs droits.
En signant cette pétition, vous demandez au gouvernement français et au ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes de mettre en place des mesures concrètes afin que toute personne victime de violences sur le territoire soit effectivement protégée. Nous demandons :
1. L’ouverture d’un droit au séjour pérenne pour toute personne victime de violences conjugales ou familiales vivant en couple ou séparée, quelles que soient la situation (mariage, Pacs, concubinage, ex), la nationalité de l’auteur∙e ou de la victime des violences et son statut administratif.
2. La reconnaissance d’un droit au séjour pour les personnes victimes des violences au-delà de la sphère conjugale ou familiale pour prendre en compte les violences qui pourraient intervenir dans l’espace public ou au travail.
3. La prise en compte de tous les éléments qui peuvent constituer des preuves des violences. Les administrations veulent des preuves, de vrais justificatifs des violences subies : au lieu de s’appuyer sur un faisceau d'indices, elles exigent abusivement des documents tels qu’une condamnation pénale de l’auteur des violences, un divorce pour faute ou un certificat médical rédigé les unités médicaux légales.
4. La simplification des dépôts de plainte pour les personnes migrantes victimes de violences sexuelles et sexistes. Le commissariat ou la gendarmerie doit savoir accueillir une victime et permettre la traduction dans une langue compréhensible par la personne venue déposer plainte.
5. L’interdiction du placement en centre de rétention administrative de toute personne victime de violences demandant de l’aide aux forces de police ou de gendarmerie.
Toutes les femmes doivent être protégées, sans distinction ! Récoltons un maximum de signatures avant le 25 novembre, journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
Dans la médiathèque de Remue Méninges féministe, on trouve :
Alaso est la revue de l’organisation féministe haïtienne Nègès Mawon.
La revue propose des contributions de féministes haïtiennes en Haïti et sa diaspora, déclinée en deux éditions bilingues (une en créole haïtien et en français, l’autre en créole haïtien et en anglais).
Aux Editions Syllepse ; 5 numéros parus
Résistans – N° 1 - 2021
Nègès Mawon présente Alaso.
Fondée en 2015, Nègès Mawon est une organisation féministe revendicatrice qui lutte pour l’émancipation des femmes et leur libération de toutes les formes de violences et d’oppression. Un siècle de luttes, de mobilisations, de confrontations, d’évolution, d’antagonismes, de victoires, mais aussi de défaites. Ce siècle, c’est celui du féminisme haïtien dont on retrouve les racines dès 1915 avec de nombreuses femmes actives au sein de l’Union patriotique contre l’occupation américaine, puis en 1934 avec la formalisation de la première organisation féministe haïtienne, la Ligue féminine d’action sociale.
Il
devient de plus en plus difficile de produire de la pensée féministe lorsque
les besoins fondamentaux de la population ne sont pas couverts, surtout dans le
contexte haïtien où l’espace de réflexion est si limité avec un État qui ne
remplit pas ses obligations minimales. Les marges sont à la fois un site
«imposé par les structures oppressives», mais aussi «un site de possibilité
radicale, un espace de résistance». Ce sont les mots de l’intellectuelle, militante
et figure du féminisme noire, bell hooks.
Ce projet vise à proposer de nouveaux modes de distribution de la pensée et de
voix féministes.
Loin
des clichés sur le féminisme du tiers-monde qui serait cantonné à l’assistance
d’urgence, Alaso est une plateforme par les femmes féministes
haïtiennes en Haïti et dans la diaspora, afin de diffuser nos idées, nos
positions, notre vision et nos aspirations.
Cette revue, déclinée en deux éditions bilingues (une en créole haïtien et en
français, l’autre en créole haïtien et en anglais), est publiée deux fois par
an : le 18 novembre (date de commémoration de la bataille de Vertière – 18
novembre 1803 – qui mit fin à la tentative de Napoléon Bonaparte de restaurer
la souveraineté de la France sur l’île) et le 3 avril, à l’occasion de la
journée du mouvement féministe haïtien.
Il s’agit ici d’affirmer la participation active des femmes haïtiennes dans la lutte de libération et à la création de la première République noire.
Fwontyè – n° 2 – avril 2022
Nous souhaitons offrir dans ces pages un espace de réflexion féministe sur la frontière. Nous ouvrons ce numéro avec celles qui ont traversé plusieurs frontières pour être repoussées à l’intérieur de celles de Haïti. Ce nouveau numéro renouvelle notre engagement féministe et vis-à-vis du projet de la nation haïtienne : la liberté, la justice et l’égalité.
Qu’est-ce que les frontières font aux corps? Telle est la question qu’explore l’écrivaine Edwidge Danticat dans son essai. Vivre, mais pas ici, mais qu’apportons-nous lorsque l’on va là-bas? La dramaturge et comédienne Gaëlle Bien-Aimé, la professeure Nathalie Batraville et la directrice de la publication Fania Noël explorent l’art de refaire avec ce qui reste, ce qui est perdu et ce qui est donné. Si la frontière elle se traverse, elle peut aussi être habitée. La réalisatrice Gessica Généus et la photographe Keylah Mellon nous offrent un regard réflexif sur leur travail, l’identité et leur réception par l’extérieur.
Et parce qu’il y a une frontière que l’on devra toutes traverser en laissant nos traces pour les autres en devenir, nous publions dans ce numéro la seconde partie de l’article de Shanna Jean-Baptiste sur la femme de demain de Jean Price-Mars. Nous avons le plaisir de clôturer ce numéro avec un texte de Wyddiane Prophète qui rend hommage à l’illustre anthropologue Suzanne Comhair-Sylvain qui a traversé et habité plusieurs frontières. Nous la publions en reconnaissance et gratitude de son travail et embrassant notre responsabilité en tant que féministes haïtiennes de combattre l’invisibilisation des femmes haïtiennes au quotidien et de leur postérité en tant qu’intellectuelles, artistes, militantes ou femmes de lettres.
Fanmi – N°3 - 2022
La question du rôle et des places (genrées) est incontournable pour avoir une approche féministe de la famille. C’est, parmi les rôles les plus ancrés dans la culture haïtienne, l’archétype de la fanm potomitan [la femme soutien de la famille], le potomitan étant le poteau central du temple vaudou – ce serait une récompense que d’être une fanm potomitan – que Doris Lapommeray nous invite à refuser.
L’autre place dans la famille, est celle de l’enfant. Darline Alexis nous propose de questionner son absence/présence/prétexte dans la littérature haïtienne.
Il sera aussi question de la famille que l’on choisit, avec les textes de Michèle Lemoine sur la famille artistique et de Jeanne-Elsa Chery sur les femmes en politique.
Qu’en est-il de la famille dont on hérite : Sharma Aurelien nous présente un état des lieux des luttes féministes autour de la question des familles monoparentales que les femmes tiennent à bout de bras. La famille et le couple restent pour les femmes l’espace de prédilection des violences patriarcales sous toutes leurs formes ; Stéphanie François et Dorvensca M. Isaac nous offrent deux textes de fictions sur le sujet.
Il sera aussi question de la famille à laquelle les femmes incarcérées sont arrachées et des liens impossibles à retisser avec leurs enfants et proches à la sortie.
Parfois, plus que d’autres, c’est une famille qui nous choisit : c’est le cas de Sergina Trenti et Jessica Lundi-Léandre, toutes les deux nées en Haïti et adoptées par des familles blanches françaises.
Poko bout – N° 4 – nov. 2023
Poko bout/Inabouti est le thème choisi pour ce numéro 4. Il fait écho au sentiment général d’inaboutissement, d’arrêt en plein vol, ressenti au niveau individuel mais aussi collectif. Inaboutissement, car sont arrêté·es en plein élan, l’ambition d’égalité de la nation haïtienne, les mobilisations politiques contre la corruption, les avancées des luttes féministes, l’année scolaire commencée et qui doit être terminée dans un pays tiers, des vies prises et celles à qui on n’a pas laissé la chance de commencer.
Alaso est désormais publiée une fois par an pour permettre une extension hors-les-pages comprenant un cycle en études féministes et de genre, inauguré à Port-au-Prince en août dernier.
Dous – N° 5 – 2024
Ce cinquième numéro, « Dous » (plaisir/désir), n’est pas une échappatoire à la réalité, mais la persistance dans le projet que représente un espace de la pensée féministe : tenir la ligne même en vent contraire. Alaso, n’étant pas une revue d’actualité n’a pas d’impératif de répondre au moment.
Anthologie féministe, chaque numéro s’attelle à créer un éclairage du présent, du passé et de l’avenir.
À la rencontre des "super geeks" de l'égalité salariale par Josephine Lethbridge
Vous pouvez lire la newsletter en ligne ici - https://lesglorieuses.fr/les-super-geeks/
La Suède est largement considérée comme un leader mondial en matière d’égalité salariale.
Depuis 2009, les employeur·es sont légalement obligé·es de déclarer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de publier des plans d’action pour remédier aux inégalités de salaire. Le pays est largement en avance depuis des années en ce qui concerne les politiques progressistes de congé parental et de garde d’enfants, qui réduisent les pénalités sur leur carrière que les femmes subissent en devenant mères. Il n’est donc pas surprenant que la Suède soit classée cinquième dans le Rapport mondial sur les inégalités de genre du Forum économique mondial.
Mais cela ne suffisait pas pour les chercheuses Marie Trollvik, Anita Harriman et Lena Johansson. Après tout, la Suède n’a pas encore atteint l’égalité : l’écart salarial y était encore de 11,1 % en 2022. “Nous avons travaillé sur ces questions toute notre vie professionnelle. Et quand nous avons pris notre retraite, nous avons refusé d’abandonner, car nous avions l’impression que personne ne prenait cela au sérieux”, raconte Marie Trollvik.
Après avoir passé leurs carrières à se travailler sur l’écart salarial de différentes manières, Marie Trollvik, Anita Harriman et Lena Johansson ont créé un cabinet de conseil qu’elles ont appelé Lönelotsarna (qui se traduit plus ou moins par “les pilotes du salaire”). Leur objectif : continuer à demander des comptes à la Suède et à ses employeur·es. Depuis 2015, Lönelotsarna publie des rapports annuels qui mettent en lumière les écarts de salaire entre les différents secteurs. Minna Cowper-Coles, experte des inégalités salariales au King’s College à Londres, a décrit les trois femmes comme des “super geeks du calcul de l’égalité salariale – mais de l’égalité pour des travaux de valeur égale”.
Lönelotsarna examine les emplois dans différents secteurs et les évalue selon plusieurs critères : le niveau de formation et d’expérience requis ; le niveau de responsabilité ; les conditions physiques et mentales du poste ; ainsi que les compétences sociales et de résolution de problèmes nécessaires. L’équipe utilise ensuite ces critères pour regrouper les emplois de valeur égale. Grâce aux données salariales exhaustives que produit la Suède, Lönelotsarna peut ensuite comparer chaque emploi dans le pays pour révéler les écarts structurels de rémunération. “C’est la différence entre les “emplois des femmes” et les autres emplois”, m’explique Marie Trollvik.
Leurs rapports démontrent systématiquement que les professions dominées par les femmes en Suède sont moins bien rémunérées que celles dominées par les hommes, même lorsqu’elles nécessitent les mêmes niveaux de compétences, de formation ou de responsabilités. Par exemple, les professeur·es de primaire et les travailleur·euses sociales sont nettement moins bien payé·es que les policier·es, alors que ces postes demandent plus de compétences, de savoirs et d’efforts. Lönelotsarna a également montré que les sages-femmes gagnent beaucoup moins que les ingénieur·es civil·es, alors que les deux métiers sont très demandés et exigent des niveaux similaires de formation, de compétences, de responsabilités et des conditions de travail comparables.
“En réponse à nos chiffres, les gens disent toujours : "Oh, c’est le marché". Mais nos rapports ont montré que lorsque le marché a besoin de professions occupées par les femmes, ces métiers ne bénéficient pas des augmentations salariales que connaissent les professions dominées par les hommes”, précise Marie Trollvik.
En voici la preuve
Le travail de Lönelotsarna offre une réponse solide aux personnes qui remettent en question le rôle de la discrimination, des stigmates et des normes patriarcales dans l’écart persistant entre les salaires des hommes et des femmes. Il montre que les forces du marché ne peuvent pas entièrement expliquer l’écart salarial entre les genres, même lorsque l’écart est “ajusté” pour comparer des postes à niveaux de compétence et de responsabilité égaux. Il révèle également la dévalorisation massive des métiers du soin.
Les tentatives de mesurer et d’expliquer cet écart ont évolué au cours des dernières décennies. Elles ont vraiment commencé à prendre de la vitesse dans les années 1970, explique Yana Rodgers, directrice du Centre pour les femmes et le travail de l’Université Rutgers. À l’époque, inspiré·es par les recherches sur les inégalités raciales de salaire, des expert·es ont commencé à mesurer les écarts de salaire entre les genres.
Elles l’ont fait en divisant l’écart en deux composantes : les différences observées entre les hommes et les femmes en termes d’éducation et d’expérience, et les différences qui étaient “inexplicables” par ces caractéristiques. “C’est la portion que certaines personnes attribuent à la discrimination, et que d’autres, en particulier les économistes néoclassiques qui ne croient pas à la discrimination, qualifieraient simplement de 'non expliquée – nous n’avons pas les données, mais si nous les avions, nous pourrions expliquer cet écart'”, explique Yana Rodgers.
Depuis, une nouvelle méthode consiste à utiliser des études de terrain pour mesurer plus directement la discrimination. Cela peut inclure l’envoi de centaines de candidatures fictives avec des prénoms reconnaissables comme masculins ou féminins, par exemple, pour mesurer les biais à l’égard des candidates féminines. Mais l’accent reste principalement mis sur l’égalité des chances au sein d’un même emploi.
Bien sûr, il est important de déterminer si un homme et une femme ayant la même formation, expérience et compétences sont payé·es le même salaire pour le même poste : si ce n’est pas le cas, il s’agit d’une discrimination claire. Mais se concentrer uniquement sur cela, comme l’ont fait les études initiales, ignore les problèmes systémiques beaucoup plus vastes qui sous-évaluent les professions à prédominance féminine (comme les soins infirmiers). La Nouvelle-Zélande et le Canada étaient à l’avant-garde de cette reconnaissance dans les années 1990 : des féministes ont commencé à exiger non seulement une égalité salariale pour le même emploi, mais aussi pour des emplois de valeur égale.
Trente ans plus tard, nous ne sommes pas beaucoup plus proches de l’équité salariale dans la plupart des pays, même ceux considérés comme des leaders de l’égalité de genre, comme l'a montré Lönelotsarna.
Travail reproductif
Aujourd’hui, il existe d’innombrables indices, tels que le Rapport mondial sur l’écart entre les genres ou l’Indice de l’égalité de genre de l’Union européenne, qui tentent de mesurer les inégalités de genre – dont une grande partie est constituée par l’écart salarial – et de les comparer à l’échelle internationale. De nombreux progrès ont été réalisés. Mais “il faut prendre chacun de ces indices avec des pincettes”, dit Yana Rodgers. “Un certain nombre d’entre eux utilisent, par exemple, les taux de participation des femmes au marché du travail. Mais un taux élevé de participation des femmes n’est pas nécessairement une bonne chose si les opportunités professionnelles des femmes sont limitées à des emplois mal rémunérés.”
Le problème n’est pas seulement ce que les expert·es appellent la “ségrégation professionnelle” : le fait que les professions à prédominance féminine ont tendance à être moins bien rémunérées. D’autres facteurs forcent régulièrement les femmes à abandonner leurs ambitions professionnelles, à quitter le marché du travail ou à choisir des professions peu rémunérées. “La principale explication des inégalités salariales entre les genres est le travail de soin, et le rôle disproportionné des femmes dans ces soins”, ajoute Rodgers.
Cela signifie que nous devons non seulement examiner la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés, mais aussi mesurer la quantité de travail non rémunéré que les personnes effectuent en dehors de leur emploi salarié.
Très peu d’indices d’égalité de genre tiennent compte correctement de ce travail. En fait, la plupart considèrent le travail reproductif non rémunéré (par exemple, cuisiner, laver les vêtements et s’occuper des enfants) de la même manière que le temps libre. Une analyse réalisée en 2022 de 17 indices de l'inégalité de genre entre pays a révélé qu’un seul – l’Indice africain du genre et du développement – se démarquait “par son objectif explicite de rendre visible le travail non rémunéré des femmes” en prenant en compte le travail reproductif non rémunéré.
Plus on examine l’écart salarial genré de près, plus cela devient complexe. De nombreux facteurs entrent en jeu : la discrimination flagrante envers les femmes sur le lieu de travail ; le fait que les femmes dominent certaines professions et pas d’autres ; la dévalorisation de ces professions ; les pénalités professionnelles que subissent les femmes lorsqu’elles deviennent mères ; les possibilités d’emploi limitées pour les femmes cherchant un travail à temps partiel ou flexible. Toutes ces discriminations sont aggravées par d’autres formes de discrimination et chacune d’entre elles pourrait faire l’objet d’une newsletter à elle seule – et elles le feront.
“Tout se résume par la valeur accordée au soin”, conclut Yana Rodgers. “Si nous sommes toutes et tous conscient·es que le marché ne valorise pas ou sous-évalue le travail de soin, alors nous réalisons que c’est la responsabilité de chacun·e d’entre nous d’y accorder plus d’importance au quotidien. Je pense que cela contribuerait à réduire les écarts de rémunération entre les genres.”
Pour comprendre ce que cela signifie en termes de politique, j’ai consulté quelques expert·es et lu plusieurs rapports (celui de Minna Cowper-Coles sur les rapports d’écarts salariaux dans six pays était particulièrement éclairant) pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Ce qui marche
• Obliger les employeur·es à publier des données sur les politiques pertinentes, notamment le congé parental, le travail flexible et les écarts de rémunération.
• Obliger les employeur·es à évaluer, déclarer et ajuster les disparités salariales pour des travaux de valeur égale, pas seulement pour les personnes occupant le même poste.
• Obliger les employeur·es à publier des plans d’action réguliers pour aborder les écarts de salaire.
• Tenir les employeur·es responsables de leurs engagements sur ces plans – non seulement par le gouvernement mais aussi par leurs employé·es. En Espagne et en France, par exemple, les représentant·es des employé·es et les syndicats valident les plans d’action des employeur·es.
• Investir dans un congé parental obligatoire (à prendre ou à perdre), des services de garde d’enfants abordables, et améliorer la rémunération dans les secteurs à prédominance féminine tels que la santé, l'éducation et les soins.
Ce qui ne marche pas
• Ne cibler que les grosses entreprises. Les petites et moyennes entreprises représentent la majorité des employeur·es dans le monde.
• Accorder trop d’importance aux chiffres des écarts salariaux globaux. Cela peut inciter les entreprises à prendre des mesures contre-productives, comme externaliser des emplois mal rémunérés dans lesquels les femmes sont concentrées (par exemple, le nettoyage).
• Parler des politiques conçues pour aider les femmes à gérer leur carrière en même temps que leurs responsabilités familiales comme des politiques spécifiquement destinées aux femmes. Cela peut entraîner une stigmatisation accrue. Au lieu de cela, les politiques doivent être neutres en termes de genre afin d’attirer tout parent qui fait du travail de soin.
• Se concentrer exclusivement sur l’écart salarial entre les genres. Les données sur d’autres catégories sociales (par exemple, l’origine ethnique, la langue maternelle) devraient être collectées – en tenant compte des droits à la vie privée et du contexte culturel – pour permettre une approche intersectionnelle.
Et maintenant, on fait quoi ?
– Dans votre communauté, faites attention à qui fait le travail non rémunéré, et pensez au coût d'opportunité - qu'est-ce que cette personne pourrait faire d'autre si elle ne prenait pas en charge ce travail ?
– Au travail demandez des congés parentaux généreux, la transparence sur les salaires et des politiques de travail flexibles
– en politique, demandez des comptes aux gouvernements, en défendant la valeur des professions non rémunérées et du travail de soin non rémunéré à la maison
Source : Newseletter Impact La preuve – 28/10/2024
Budget 2025. Six mesures pour vraiment taxer les plus fortunés
Laurent Jeanneau, 23 Octobre 2024
Pour concilier contraintes budgétaires et véritable justice fiscale, le gouvernement pourrait davantage mettre à contribution les plus riches. D’autant que pour y parvenir, les outils ne manquent pas.
« Je ne vais pas exclure de l’effort national les personnes les plus fortunées. » Michel Barnier avait annoncé la couleur en amont de la présentation du budget 2025, dès le 22 septembre sur France 2. Mais la montagne a accouché d’une souris.
Principale innovation fiscale présentée par le gouvernement : un impôt minimum de 20 % pour les plus hauts revenus. Une mesure présentée comme « exceptionnelle, temporaire et ciblée », à tel point que seuls 24 300 foyers seraient concernés, selon Bercy. Le ministère de l’Economie table ainsi sur 2 milliards d’euros de recettes par an jusqu’en 2027, date de péremption du dispositif. Il est pourtant possible – et nécessaire – d’aller beaucoup plus loin.
Mieux s’outiller pour consolider la justice fiscale nécessite avant tout de bien comprendre comment les riches parviennent à y échapper. Quand on roule sur l’or, il existe en effet deux manières d’alléger sa feuille d’impôts. La première est bien connue : utiliser des niches fiscales qui, pour un revenu taxable donné, diminuent le montant de l’impôt. La seconde consiste à réduire directement le revenu taxable : le taux d’imposition ne change pas, mais l’enveloppe à taxer, elle, diminue. Face à ces deux attitudes, six mesures sont possibles.
1/ Raboter les niches fiscales les plus inégalitaires
Les niches fiscales – ces dispositifs dérogatoires au taux d’imposition officiel – coûtent un « pognon de dingue » aux finances publiques. La note devrait s’élever à 85,1 milliards d’euros en 2025, selon le projet de loi de finances. Or, parmi les 474 dérogations qui permettent de réduire ses impôts, certaines favorisent plus particulièrement les riches.
C’est le cas du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, la deuxième niche fiscale la plus onéreuse, qui a coûté 6,7 milliards au budget de l’Etat en 2024. Avec un risque d’effet d’aubaine élevé, comme le note la Cour des comptes : les riches ont les moyens de financer eux-mêmes leur personnel de maison et le feraient de toute façon même sans aide de l’Etat.
De quoi justifier un sévère coup de rabot, que les sages de la rue Cambon chiffrent à 1,7 milliard d’euros, notamment sur les activités de confort (ménage, jardinage, bricolage) qui concernent les deux tiers du crédit d’impôt.
On pourrait également cibler les principales niches fiscales qui permettent aux plus fortunés de réduire les taxes qu’ils payent sur l’héritage. Comme les exonérations dont bénéficient les contrats d’assurance-vie, qui coûtent 4 à 5 milliards par an. Ou encore le pacte Dutreil, qui exonère la transmission de biens professionnels (comme les actions d’une entreprise) via un abattement de 75 %, non plafonné, si l’héritier conserve les titres pendant quatre ans. Soit une perte fiscale estimée à 2 ou 3 milliards.
On peut également citer le démembrement de propriété, qui permet de donner uniquement la nue-propriété d’un bien et d’en conserver l’usufruit jusqu’à sa mort. Le donateur conserve le droit d’utiliser son bien et de percevoir les revenus qu’il procure (comme un loyer par exemple), mais les impôts dus sont calculés à partir de la valeur de la nue-propriété, plus faible que la valeur de la pleine propriété. Et au décès du donateur, la reconstitution de la pleine propriété s’opère sans perception de droits complémentaires, avec là aussi un manque à gagner de 2 à 3 milliards d’euros pour les finances publiques.
Au total, selon le Conseil d’analyse économique (CAE), 300 milliards d’euros sont transmis chaque année, soit plus de 15 % du produit intérieur brut (PIB). Mais seuls 35 à 40 % de ces transmissions sont déclarées à l’administration fiscale. Le top 0,1 % des héritiers les mieux dotés ne paie que 10 % de droits de succession grâce à ces niches, bien loin des 45 % qu’ils sont censés régler selon le barème officiel.
Autre avantage fiscal qui améliore les fins de mois des plus aisés : l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite. Cette ristourne a coûté 4,8 milliards d’euros aux caisses publiques en 2024, dont 30 % profitent aux 10 % les plus riches, qui y gagnent 900 euros par an en moyenne, selon les calculs du Conseil des prélèvements obligatoires. L’institution préconise de n’en faire bénéficier que les retraités les moins favorisés.
2/ Taxer les revenus non distribués des sociétés
Le taux plancher de 20 % imaginé par Michel Barnier vise justement à limiter le bénéfice de l’usage des niches fiscales. Mais son effet restera limité, car en réalité, rares sont les très riches qui paient moins de 20 % d’impôts sur leurs revenus. Ce taux oscille plutôt autour de 25 % pour les Français qui font partie des 0,1 % les plus riches, selon l’Institut des politiques publiques (IPP).
« Car depuis 2013, les niches fiscales sont plafonnées à 10 000 euros, ce qui rend difficile pour les ménages touchant plus de 500 000 euros de revenu taxable de tomber sous la barre des 20 % », explique l’économiste Gabriel Zucman, sur le réseau social X.
Pour réduire leur facture fiscale, les ultra-riches préfèrent la deuxième option : minorer leur revenu taxable. Certains contribuables ont en effet le privilège de pouvoir piloter le montant de leur revenu imposable. C’est notamment le cas des chefs d’entreprise, qui peuvent déterminer eux-mêmes leur mode de rémunération, en se versant tantôt un salaire, tantôt des dividendes, selon ce qui les arrange.
Si la fiscalité des dividendes ne leur est pas favorable, ils peuvent placer les bénéfices de leur entreprise en réserve en attendant une législation plus accommodante. Pour cela, ils ont souvent recours à des sociétés « holding », dont la seule activité est de détenir des participations financières, qui perçoivent les dividendes en tant que personne morale. Comme ces dividendes sont perçus par une société, ils sont soumis aux règles de l’impôt sur les sociétés (IS), et comme l’entreprise de départ a déjà payé l’IS, la société mère (la holding) ne peut pas y être soumise une deuxième fois, mais doit s’acquitter à la place d’une taxe modique, appelée « quotes-parts pour frais et charge ».
Ces holdings jouent donc le rôle de « réserve d’épargne défiscalisée » ou « tirelires défiscalisantes », comme les qualifie un rapport d’information parlementaire. Résultat, les milliardaires parviennent à ne quasiment pas payer d’impôt sur le revenu. 20 % de zéro, ça ne vole pas haut…
Et ce n’est pas parce que ces ultra-riches stockent leurs revenus dans leur patrimoine professionnel qu’ils sont sans le sou pour faire face à leurs dépenses courantes : pour financer leur train de vie, ils peuvent revendre leurs titres dont les plus-values sont les plus faibles, pour éviter de payer trop d’impôts, ou avoir recours à l’emprunt, en mettant leur patrimoine professionnel en garantie.
Aux Etats-Unis, ce type de holding est soumis à une taxe spécifique de 20 % sur les revenus non distribués. De quoi dissuader les entrepreneurs américains d’y loger les dividendes d’une société qu’ils contrôlent pour éviter l’impôt sur le revenu. Mais, en Europe, la directive dite « mère-fille » interdit la taxation d’une société sur les dividendes issus d’une filiale.
Comme le suggère l’IPP, une alternative consisterait au moins à taxer les actionnaires qui sont des personnes physiques, à défaut des actionnaires sous forme de personnes morales. Mais il faudrait alors s’assurer que ces revenus non distribués sont bel et bien à disposition des actionnaires. Car le Conseil constitutionnel veille au grain. Pour lui, ces actifs ne constituent pas vraiment de l’argent à disposition des très riches : ils ne le deviennent que lors de la vente de leur titre. Les Sages considèrent donc qu’ils ne font pas partie de la capacité contributive des très riches.
Face à cette difficulté, le Conseil des prélèvements obligatoire plaide plutôt pour augmenter le taux de l’impôt sur les sociétés et le rendre progressif, « puisqu’il s’agit, de fait, du premier impôt acquitté par les détenteurs du capital ». Ou augmenter les « quotes-parts pour frais et charge » des holdings, c’est-à-dire la modique taxe qu’elles doivent payer quand elles reçoivent des dividendes.
De son côté, l’économiste Gabriel Zucman plaide pour remplacer le taux minimum de 20 % du revenu fiscal imaginé par Michel Barnier par un taux minimum exprimé en pourcentage du patrimoine, même s’il s’agit bien de payer l’impôt sur le revenu. Ciblé sur ceux dont le patrimoine dépasse 100 millions d’euros, il établirait un taux d’imposition plancher sur le revenu d’au moins 2 % de leur fortune. De quoi rapporter 15 à 25 milliards d’euros, selon les estimations de l’économiste.
Une telle taxation serait d’autant plus légitime que les inégalités de patrimoine ont explosé ces vingt dernières années, comme le rappelle l’Insee : entre 1998 et 2021, en euros constants (c’est-à-dire corrigé de l’inflation), le patrimoine brut moyen des 10 % les moins bien dotés a baissé de 54 %, alors que celui des 10 % les mieux dotés a augmenté de 94 %.
3/ Rétablir et rénover l’ISF
Autre possibilité : réhabiliter l’impôt sur la fortune (ISF). Sa suppression par Emmanuel Macron s’est traduite par une perte sèche pour les caisses de l’Etat de 4 milliards d’euros en 2022. Avec un gain de 100 000 euros pour les 1 300 foyers les plus aisés de France, selon la commission des Finances du Sénat.
Le plus simple – et le plus sûr juridiquement – serait de revenir en arrière. Mais cette solution n’est pas entièrement satisfaisante, car cet impôt était mité : les sommes dues sont plafonnées à 75 % du revenu imposable et les biens professionnels sont exonérés. Or, comme on l’a vu, les ultra-riches sont passés maîtres dans l’art de réduire leur revenu imposable et de brouiller la frontière entre patrimoine privé et professionnel. Résultat : les très grandes fortunes arrivaient à se débrouiller pour réduire significativement leur ISF. Un comble.
Le think tank Terra Nova propose donc de coupler le rétablissement de l’ancien ISF avec un impôt à taux très bas (0,3 %), non plafonné, sur les biens professionnels, dès lors qu’ils dépassent 10 millions d’euros. Cet ISF rénové rapporterait 5 à 6 milliards d’euros.
La fondation Jean-Jaurès fait une proposition similaire, mais suggère également de relever le seuil d’entrée dans l’ISF à 2 millions d’euros et d’en renforcer la progressivité, en créant trois tranches. L’objectif étant de recentrer l’ISF sur les très grandes fortunes.
Certaines ONG, comme Greenpeace et Oxfam, proposent en complément la création d’un « ISF vert », via un malus écologique supplémentaire pénalisant la détention de patrimoine polluant. Selon leurs calculs, cette « surtaxe carbone » permettrait d’ajouter plus de 7 milliards d’euros à l’ISF tel qu’il existait avant 2017. Reste à dresser la liste des actifs polluants… qui risque d’être longue ! Seulement 1 % des fonds d’investissement auraient un portefeuille compatible avec les accords de Paris, selon une étude de Carbon Disclosure Project.
4/ Haro sur la « flat tax »
Autre mesure fiscale emblématique d’Emmanuel Macron sur la sellette : la « flat tax » sur les revenus du capital. Ce « prélèvement forfaitaire unique », de son vrai nom, permet de taxer les revenus financiers (dividendes, plus-values mobilières…) à un taux unique de 30 %, en lieu et place du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Un cadeau fiscal de 8 milliards d’euros pour le 1 % des Français les plus riches, selon le Conseil des prélèvements obligatoires.
Le Nouveau Front populaire propose de supprimer la « flat tax », en réintégrant les revenus du capital concernés au barème de l’impôt sur le revenu. De quoi dégager 2,5 milliards d’euros. A défaut, il serait également possible d’augmenter son taux de 30 à 33 %, comme le proposait un rapport d’information parlementaire. De quoi rapporter 1,6 milliard d’euros de plus.
5/ Ne plus effacer les plus-values latentes
Dans une récente note sur la taxation des plus fortunés, le think tank Terra Nova préfère s’assurer que tout le monde paie bel et bien ces 30 %. Ce qui n’est pas le cas des plus riches. Avec quelle entourloupe ?
Comme nous l’expliquions plus haut, un dirigeant d’entreprise peut « piloter » dans le temps ses revenus et en différer le versement pour attendre que la fiscalité lui soit plus favorable. Notamment en mettant en réserve les bénéfices de son entreprise, au lieu de se verser un salaire ou des dividendes.
Or, cette mise en réserve fait mécaniquement augmenter la valeur des titres détenus par ce même dirigeant. De quoi faire grimper la plus-value qui serait perçue s’il vendait ces titres. Mais comme il les garde pour le moment, cette plus-value n’est pas encore réalisée, elle est dite « latente ». Et tant que la plus-value n’est pas réalisée, elle n’est pas taxée. Et elle ne le sera jamais si ces titres sont transmis à titre gratuit dans le cas d’un héritage, par exemple. La plus-value latente est alors « purgée », elle est remise à zéro au moment de la succession.
Cette spécificité hexagonale fait de la France « un paradis fiscal pour les plus fortunés », selon Terra Nova. Le think tank propose donc de supprimer cet avantage pour un gain évalué à 4 milliards d’euros.
6/ Modifier le barème de l’impôt sur le revenu
Pour mettre à contribution les plus riches, il est également possible d’augmenter les tranches supérieures de l’impôt sur le revenu. Historiquement, le taux maximal d’imposition (celui de la tranche supérieure) dépassait les 70 % en France dans les années 1950, contre 45 % aujourd’hui. Mais revenir à ce niveau semble improbable car le Conseil constitutionnel censurerait probablement une telle disposition, comme il l’a fait avec la taxe à 75 % sur les millionnaires voulue par François Hollande en 2012.
D’après Terra Nova, pour rester dans les clous de la Constitution, il ne faut pas dépasser la barre de 65 % de prélèvement maximum1. Si l’on additionne l’impôt sur le revenu avec la CSG (Contribution sociale généralisée), la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) et la taxe exceptionnelle de 4 % sur les hauts revenus, on est actuellement en France à un taux marginal supérieur « tout compris » de 55 %. Il reste donc de la marge.
Se rapprocher de la limite constitutionnelle en augmentant les deux dernières tranches du barème, respectivement de 41 % à 45 % et de 45 % à 55 %, rapporterait 2,4 milliards d’euros, selon le think tank.
Les idées ne manquent donc pas. Et les députés ne sont pas en reste. Lors de l’examen du projet de loi de finances 2025 en commission des Finances de l’Assemblée nationale, de nombreux amendements ont été votés pour muscler la copie du gouvernement, comme le relèvement de 30 % à 33 % de la « flat tax », une taxation accrue des « superdividendes », la restriction du pacte Dutreil, la pérennisation de l’impôt minimum de 20 % sur les hauts revenus, etc.
Mais le nouveau texte a finalement été rejeté le 19 octobre en commission des Finances. Retour à la case départ : c’est sur la base du projet initial du gouvernement que le débat parlementaire a repris, lundi 21 octobre, dans l’hémicycle. Un projet largement perfectible.
Comment les cathos réactionnaires s’infiltrent dans les sphères de pouvoir
Rozenn Le Carboulec, journaliste indépendante, membre du collectif Hors Cadre
Un mois après la nomination du gouvernement Barnier et malgré les gages donnés par le nouveau Premier ministre sur les droits reproductifs et pour les personnes LGBT+, l’influence des milieux catholiques réactionnaires sur ses ministres inquiète dans les milieux féministes et LGBT+. En l’espace de dix ans, La Manif pour tous a certes perdu en influence, mais d’autres groupes de pression, bénéficiant d’un fort soutien médiatique, sont passés à l’action – dans l’enseignement notamment.
Le Premier ministre, Michel Barnier, l’a promis le 22 septembre dernier sur France 2 : il ne reviendra pas sur les droits sociaux acquis tels que la procréation médicalement assistée pour toutes ou l’accès à l’avortement. Mais quelle confiance accorder à ces déclarations, quand son gouvernement a pour têtes d’affiche des ministres proches des milieux réactionnaires catholiques ?
Bruno Retailleau (Intérieur) fait partie des plus fervents soutiens du mouvement de La Manif pour tous (LMPT) – renommée en 2023 Le Syndicat de la famille. Comme d’autres ministres – Catherine Vautrin (Partenariat avec les territoires et Décentralisation de la France), Annie Genevard (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Forêt), Patrick Hetzel (Enseignement supérieur et Recherche), François-Noël Buffet (Outre-mer) et Sophie Primas (chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger) –, il a voté contre la loi Taubira instituant en 2013 le mariage pour toustes, puis, à l’instar d’Othman Nasrou (secrétaire d’État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations), a longtemps soutenu son abrogation. Comme Laurence Garnier (secrétaire d’État chargée de la Consommation), il a voté en 2022 contre l’interdiction des thérapies de conversion (qui prétendent guérir les personnes homo- ou bisexuelles de leur orientation sexuelle, comme si elles étaient malades), et contre la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) à l’hiver 2024.
À part Retailleau, ce sont quand même des seconds couteaux, des résidus de La Manif pour tous, tempère Céline Béraud, sociologue, spécialiste des questions de genre et des religions à l’École des hautes études en sciences sociales. Ils sont allés chercher celles et ceux qui restaient chez Les Républicains, c’est-à-dire des personnes issues de la droite très conservatrice. » Avec seulement 47 député·es du groupe Droite républicaine (ex-Les Républicains) à l’Assemblée nationale, ce gouvernement n’aura selon elle pas la force de frappe suffisante pour « désanctuariser » les droits liés à l’IVG et aux familles LGBT+ : « Leur parti ne représente rien. »
Mais les associations féministes ne se disent pas rassurées pour autant. « Si on ne met ni volonté politique ni moyens financiers, il n’y a pas besoin de toucher aux lois pour restreindre les droits », pointe Véronique Sehier, rapporteure de l’étude « Droits sexuels et reproductifs en Europe », publiée en 2019 par le Conseil économique, social et environnemental. Elle mentionne, pour exemple, une étude régionale réalisée par le Planning familial, dont elle a été co-présidente. « Dans les Hauts-de-France, seul un centre d’IVG sur deux pratique actuellement des interruptions de grossesse jusqu’à la fin de la quatorzième semaine, comme le prévoit pourtant la loi. »
Le noyautage des associations d’usagers
Surtout, « il ne faut pas sous-estimer les réseaux catholiques », explique Céline Béraud. Car si La Manif pour tous a indéniablement perdu en influence depuis 2013, de nombreuses organisations satellites ont continué à se développer. Parmi celles qui ont « gagné en professionnalisation et en visibilité », la sociologue cite les Associations familiales catholiques (AFC), à l’origine du lobbying exercé sur les sénateur·ices contre l’inscription de l’avortement dans la constitution à l’hiver 2024 ; mais également l’association anti-IVG Alliance Vita, créée par Christine Boutin, dont le délégué général, Tugdual Derville, a été porte-parole de La Manif pour tous en 2013.
« Les Associations familiales catholiques, sous l’égide de l’Union départementale des associations familiales, sont entrées dans un certain nombre de structures comme représentantes des usagers, et c’est ça qui est inquiétant aujourd’hui », commente Véronique Sehier. En mars dernier, elles demandaient la suppression des « très nombreuses références au genre » dans le programme d’éducation affective et sexuelle mis en place en 2001 dans les établissements scolaires, dans le parfait prolongement de leur lutte contre le programme pédagogique « les ABCD de l’égalité » en 2013.
UNE ACCÉLÉRATION DES PANIQUES RÉACTIONNAIRES À L’UNIVERSITÉ
Les questions liées à l’identité de genre sont au cœur de la bataille que livrent « les héritiers de La Manif pour tous », comme les appelle Maud Royer, présidente de l’association féministe Toutes des femmes, et autrice du Lobby transphobe (Textuel, 2024). Dans une chronique publiée dans le numéro 15 de La Déferlante, elle rappelle l’alliance tacite conclue entre « les groupes “antigenre”, proches des droites catholiques » et « les franges les plus réactionnaires de la psychanalyse et de la psychiatrie ». Sociologue des médias, Karine Espineira fait le même constat : dans Transidentités et transitudes. Se défaire des idées reçues (Le Cavalier Bleu, 2024, coécrit avec Maud-Yeuse Thomas), elle explique que « l’ensemble des mouvements “anti” a investi la scène médiatique et “contaminé” progressivement la sphère politique depuis 2011 ». C’est ainsi que, au printemps 2024, une proposition de loi interdisant les transitions de mineur·es, largement inspirée du rapport d’un groupe de pression transphobe (l’Observatoire la Petite Sirène), a été adoptée au Sénat.
« Une resucée de la théorie “antigenre” »
Davantage que la remise en question de droits acquis, Céline Béraud craint aujourd’hui l’accélération des paniques réactionnaires visant en particulier, dans l’enseignement supérieur, les études de genre et les études postcoloniales. « Mon ministre, Patrick Hetzel, est de ceux qui ont fait enfler la polémique sur le “wokisme” à l’université, qui est une sorte de resucée de la “théorie antigenre” » que brandissent les milieux catholiques, arguant que le genre n’est pas une construction sociale. La sociologue s’inquiète également des rapports de force au sein des établissements scolaires. Des personnalités conservatrices comme Alexandre Portier, ministre délégué à la Réussite scolaire et à l’Enseignement professionnel, pourraient y trouver des relais associatifs comme le Syndicat de la famille ou le mouvement SOS Éducation, qui prétend réunir parents et professeurs et qui est proche de l’extrême droite. Ces réseaux pourraient lancer de nouvelles polémiques sur les enfants trans ou l’éducation sexuelle à l’école.
Dans ce contexte inquiétant pour les droits des minorités sexuelles et de genre, la nouvelle secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Salima Saa, déplorait à la fin de septembre que la loi de 2001 prévoyant trois séances annuelles d’éducation à la sexualité à l’école ne soit pas appliquée. Une déclaration surprenante, car totalement à contre-courant des positions affichées par une bonne partie de ses collègues du gouvernement. La secrétaire d’État risque de se retrouver bien seule pour passer à l’action.
Source : Newsletter La Déferlante 25/10/2024
Spectacles, expos, etc...
Film La déposition
«Honte croix». Voilà comment j’ai détourné le slogan féministe contre les violences sexistes et sexuelles «On te croit» après avoir vu le documentaire de Claudia Marschal. La question de la foi est une affaire personnelle, qui, lorsqu’elle empiète sur l’espace public, conduit généralement à l’intolérance et à la violence. Je suis toujours perplexe de ces débordements multiples, qui se font au nom des dieux.
La déposition, c’est l’histoire d’un garçon de treize ans, qui est abusé par le prêtre de sa paroisse. Les mêmes ingrédients sont au rendez-vous : «Ce sera notre petit secret», «Ne le dis à personne» et comme toujours, le tour de force qu’opère le prédateur, c’est de localiser honte et culpabilité chez la victime. Celui qui commet l’acte aura pour seule ligne de conduite le déni : «Ça n’a pas eu lieu», «C’est une invention de l’enfant».
Les parents d’Emmanuel Siess sont restaurateurs en Alsace, ils ont d’abord deux filles, Emmanuel sera le troisième enfant. Lorsqu’on est commerçant·es, on est peu disponibles pour être parents. Emmanuel va trouver refuge et appui dans sa solitude auprès d’Hubert, le prêtre, dont il parle beaucoup, qu’il apprécie et admire. Lui au moins, il peut accorder de l’attention à Emmanuel. En 1993, Emmanuel se rend à bicyclette au presbytère. En chemin, une pluie intense fait qu’à son arrivée, il est trempé. Le prêtre n’est pas là, Emmanuel l’attend. Lorsqu’enfin, il revient, Hubert propose au jeune garçon d’entrer, l’invite à se déshabiller pour mettre ses vêtements à sécher. Le dérapage a lieu. Des attouchements, qui provoquent de la sidération et la promesse de n’en jamais rien dire.
Trente ans s’écoulent. Emmanuel va en parler bien plus tard à sa mère depuis décédée. Lorsqu’Emmanuel se convertit au protestantisme auprès d’une église évangélique, son père s’inquiète et va trouver le prêtre pour savoir ce qui s’est passé avec son fils. Le prêtre le rassure et va envoyer une lettre «apaisante» à Emmanuel. C’est intolérable pour l’homme qu’il est devenu. L’irrecevable de ce qui ressurgit après un enfouissement d’une trentaine d’années va conduire Emmanuel à déposer plainte à la gendarmerie. Il va également prendre contact avec l’archevêque du diocèse. Le traumatique contenu jusqu’alors ne peut plus rester secret.
Ce qui est remarquable dans ce film, c’est que c’est bien la victime, qui est le personnage central. A la différence d’un procès judiciaire, où l’accusé est la vedette. Ici, le «père Hubert» n’est qu’un détail de l’histoire. Un détail monstrueux, mais seuls ses agissements malsains comptent. Films en super 8, photos de l’époque ponctuent le film. Ce qui est le plus flagrant, c’est de voir le visage poupin de ce garçonnet de treize ans. Ce qui nous saute au visage, c’est combien les pédocriminels se fourvoient en supposant qu’ils offriraient de l’amour à un jeune homme ou bien encore qu’ils auraient succombé à ses assauts séducteurs.
Ce qui nous surprend aussi dans «La déposition», c’est l’accueil bienveillant et compréhensif fait aux aveux d’Emmanuel tant à la gendarmerie, qu’auprès des instances catholiques. On le croit. Ce qu’il énonce n’est pas mis en doute. On lui fait préciser les événements à la gendarmerie tout en se montrant respectueux de la pénibilité de se remémorer de façon lacunaire les faits. L’archevêque souligne le fait qu’il est habituel que la victime se sente coupable dans de telles situations. On aimerait que lorsque les victimes déposent plainte, cela devienne la norme d’être ainsi accueillies. La suspicion à leur endroit ne doit plus primer.
La déposition, ce sont également les échanges entre Emmanuel et son père et l’intensité croissante de ce qui va peu à peu les relier jusqu’à une sorte de «Je te crois» du père à son fils. Au nom du père, du fils, mais pour le «sain esprit», l’Église catholique a encore du chemin à accomplir. Le prêtre officie encore (en-corps ?), l’archevêque a lui été déplacé… Quant aux faits, le délai de prescription s’est appliqué et la plainte a donc été classée sans suite.
Daniel Charlemaine 50-50 Magazine
https://www.50-50magazine.fr/2024/10/24/chronique-lai-du-psy-la-deposition-de-claudia-marschal/
L’exposition Janine Niépce, regard sur les femmes et le travail se tiendra dans le hall Defrasse de la Cité de l’Économie du 3 octobre 2024 au 5 janvier 2025.
Horaires : du mardi au dimanche de 14h à 18h, et jusqu’à 19h les samedis
Billet inclus dans celui de l'exposition permanente.
1 place du Général Catroux 75017
M° Villiers Montceau – Villiers Malesherbes
"Janine Niépce, regard sur les femmes et le travail" met à l’honneur les photographies de l’artiste, témoin des évolutions de la place des femmes pendant la seconde partie du 20e siècle. Organisée en trois parties, elle offre une plongée dans le quotidien des femmes des années 50 à 90, mettant en lumière leur contribution essentielle à la société, leurs luttes pour leur affranchissement vis-à-vis de la maternité et pour l’égalité et enfin leur évolution au sein du monde du travail. Janine Niépce est l’une des premières photographes à mettre en lumière le quotidien des femmes dans leur foyer, effectuant en son sein un travail non salarié et non reconnu par la société mais pourtant créateur de valeur. Elle photographie l’intégration de la société par ces femmes qui sortent de leur foyer ainsi que les signes d’émancipation féminine comme l’accès des jeunes femmes à des filières scientifiques, nouvelles modes (coupe à la garçonne, mini-jupe, pantalons), jeunes gens attablés à des cafés, femmes qui fument…
Les luttes féministes ont accompagné des changements sociaux fondamentaux, telles la légalisation de la contraception (loi Neuwirth en 1967) et l’Interruption Volontaire de Grossesse (loi Veil en 1975). Autant d’événements majeurs que Janine Niépce a suivi entre 1965 et 1980, tout en immortalisant des personnalités telles que Simone Veil, Colette, ou encore Elisabeth Badinter. Suite à ces grandes luttes féministes et à l’évolution des mœurs, de plus grandes possibilités de carrières s’ouvrent pour les femmes. Janine Niépce photographie ces avocates, ouvrières, scientifiques ou encore maitresses d’œuvre sur des chantiers qui accèdent à des métiers jusqu’alors réservés aux hommes. Elle immortalise également les femmes qui travaillent dans les métiers du soin, institutrices, sages-femmes, infirmières…, ces professions essentielles à la société, majoritairement occupées par des femmes, et encore mal rémunérées de nos jours.
Janine Niépce fait partie du courant « humaniste » de la photographie d’après-guerre. Bien que parisienne, elle se sent proche des vignerons bourguignons dont est issue sa famille, dont la modernité change les modes de vie. Elle traduira à travers son travail cette France en pleine mutation, entre reconstruction et tradition. C’est dans un Paris occupé qu’elle fait ses études universitaires et découvre la photographie. Révoltée par l’occupation nazie, elle s’engage dans la Résistance en développant des films pour les réseaux de renseignement, puis, en tant qu’agent de liaison, participe à la Libération de Paris. Devenue par la suite photoreporter, elle sillonne les routes de France pour documenter la vie de ses contemporains, de l’intimité de leurs foyers aux lieux de travail de métiers en voie de disparition. Dans un domaine encore largement occupé par les hommes, comme en atteste sa participation à l’exposition Six photographes et Paris en 1960 dans laquelle elle est la seule femme, elle parvient à s’imposer dès 1957 avec sa première exposition personnelle. Son travail documentaire l’emmène jusqu’au Japon, au Cambodge, en Inde, aux États-Unis dans les années 1960. Elle couvre également les changements de son époque, de la mutation professionnelle des femmes aux événements de mai 68.
La terreur masculiniste. Stéphanie Lamy. Editions du Détour, 2024, 18,90€
En réaction aux avancées féministes, partout dans le monde, des hommes radicalisés se livrent à des actions violentes pour entraver l’émancipation des femmes et des minorités. Les pouvoirs publics peinent à identifier les idéologies masculinistes pour ce qu’elles sont : un ensemble de thèses conspirationnistes participatives, qui peuvent motiver des individus ou des groupes au passage à l’acte violent, aussi bien dans la sphère privée (violences domestiques) que publique (violences sexuelles, harcèlements massifs en ligne jusqu’à des attentats meurtriers) et dont l’objectif est de reconsolider la domination masculine. Le livre dresse un panorama de ces groupes antiféministes, avec leur diversité, leur organisation, leurs business, leurs soutiens, leurs moyens d’action (notamment via les Gafam), la manière dont ils s’articulent avec d’autres courants antidémocratiques. Il étudie aussi les mécanismes par lesquels leur dangerosité est minorée : « pères privés d’enfants », « misère sexuelle », « éternels éconduits »… Il montre enfin que derrière ces profils d’hommes violents et qu’on croit marginaux s’est développé un courant de pensée politique dangereux, centré sur la quête du monopole des pouvoirs. Il est urgent d’agir contre l’idéologie masculiniste, profondément misogyne, et de revoir nos politiques sécuritaires à cette aune.
Il est où le patron ? Chroniques de paysannes
Maud Bénézit et Les paysannes en polaire. Editions Marabout, 2021
De jeunes paysannes combatives et passionnées gèrent leur propre ferme et se heurtent au machisme du milieu agricole. On leur demande souvent : il est où le patron ?
Au fil d’une saison agricole, dans un petit village de moyenne montagne, trois femmes paysannes, voisines de marché, se rencontrent, s’entraident et se lient d’amitié. Elles ont des parcours de vie différents : Jo vient de terminer ses études et s’installe tout juste pour reprendre une ferme caprine. Il y a cinq ans, Anouk a quitté la ville où elle habitait pour emménager à la campagne, depuis, elle est apicultrice. Coline, mariée deux enfants, est originaire du village. Elle a repris il y a dix ans la ferme et les brebis laitières de ses parents. Toutes trois sont confrontées au sexisme ambiant. En les suivant dans la pratique de leur métier, on accompagne leur cheminement quotidien sur les questions féministes et aussi sur la difficulté de la vie agricole. En partageant leurs expériences, ces femmes se donnent la force de faire entendre une autre voie que celle du patriarcat.
Voir quelques pages : https://www.liseuse-hachette.fr/?ean=9782501149396
Algues vertes, l'histoire interdite. La BD par Inès Léraud journaliste, Pierre Van Hove illustrateur, Mathilda coloriste. Editions Delcourt
Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts sur les plages bretonnes. L'identité du tueur est un secret de polichinelle : les algues vertes. Un demi-siècle de fabrique du silence raconté dans une enquête fleuve.Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant d'être autopsiés, des jeux d'influence, des pressions et un silence de plomb. L'intrigue a pour décor le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines d'années. Inès Léraud et Pierre Van Hove proposent une enquête sans précédent, faisant intervenir lanceurs d'alerte, scientifiques, agriculteurs et politiques.
Voir quelques pages : https://www.editions-delcourt.fr/bd/preview/algues-vertes-l-histoire-interdite
Algues vertes. Le film réalisé par Pierre Jolivet
Après plusieurs morts suspectes, la journaliste Inès Léraud décide en 2015 de s'installer en Bretagne pour enquêter de manière plus approfondie sur le phénomène des marées vertes. Elle rencontre de nombreuses personnes, et réalise l'ampleur du silence1 entourant cette question environnementale. En effet, les intérêts de l'industrie agroalimentaire sont très forts dans cette région. Elle s'appuie sur les personnes engagées sur ce combat en local pour le faire reconnaître au niveau national par ses reportages radio.


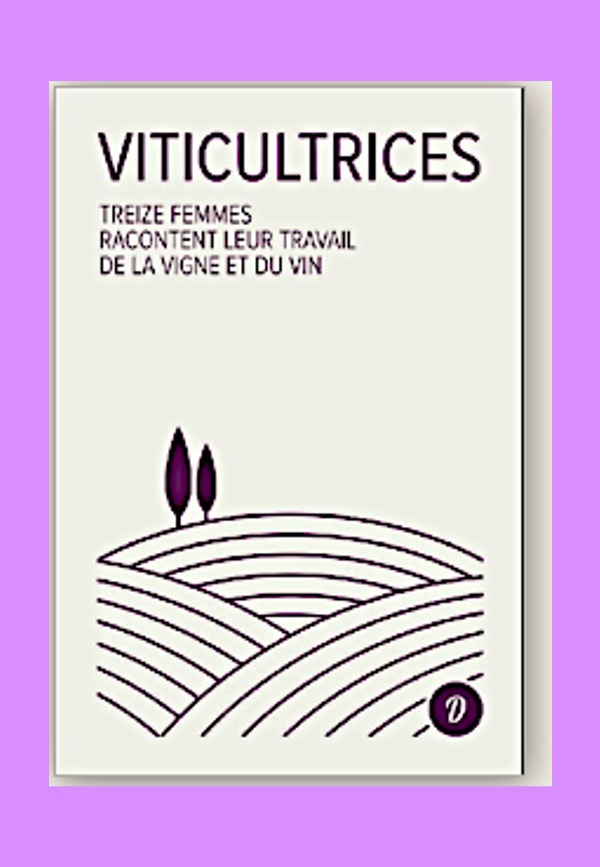
Commentaires
Enregistrer un commentaire